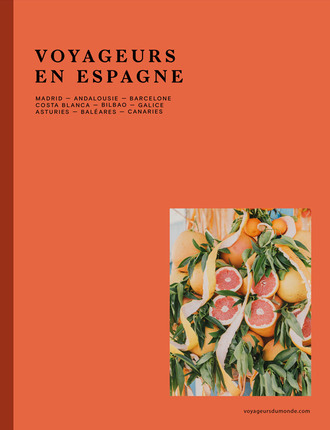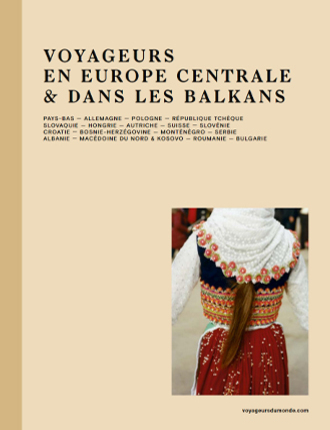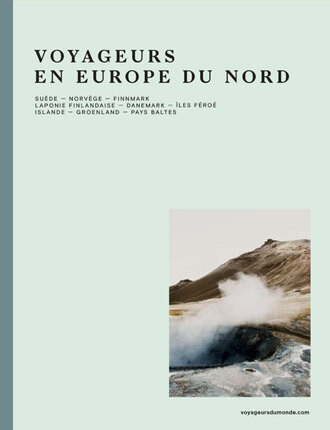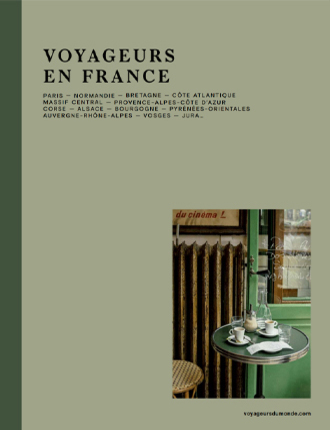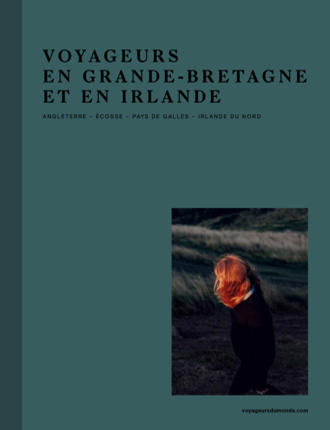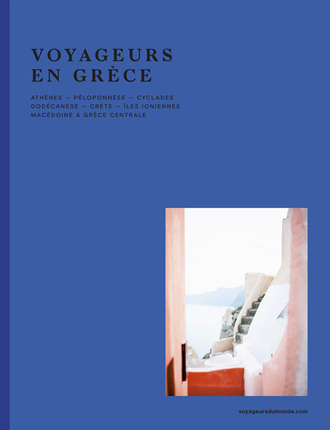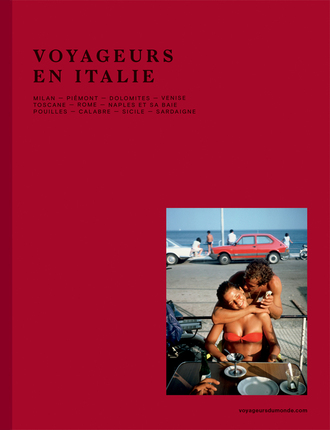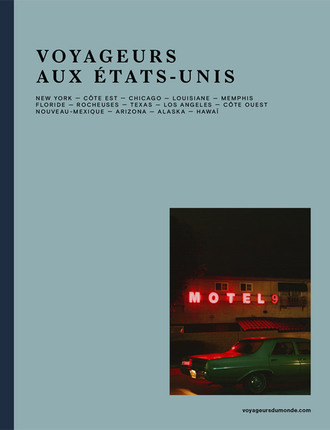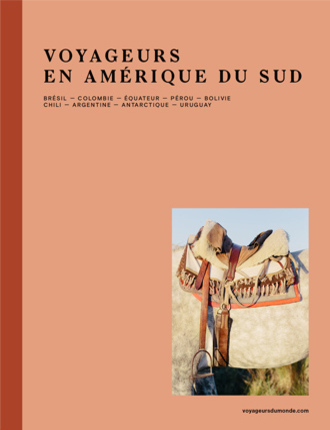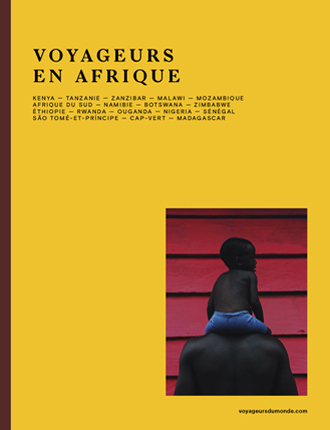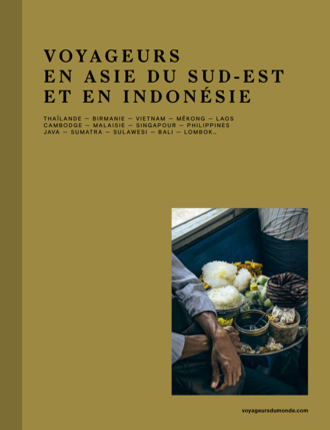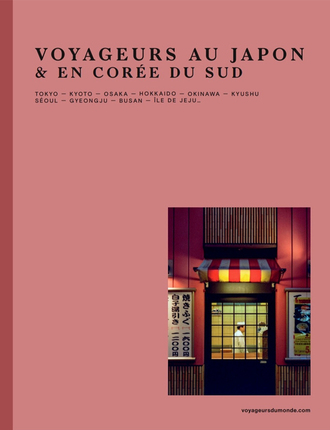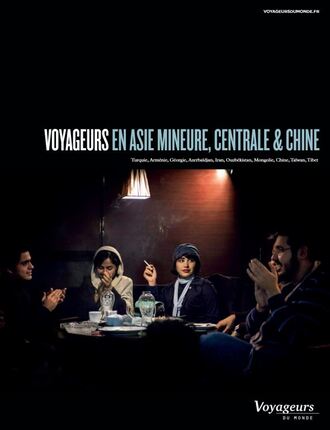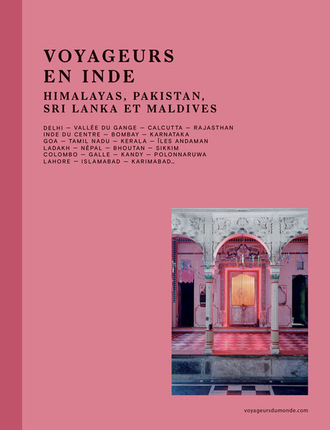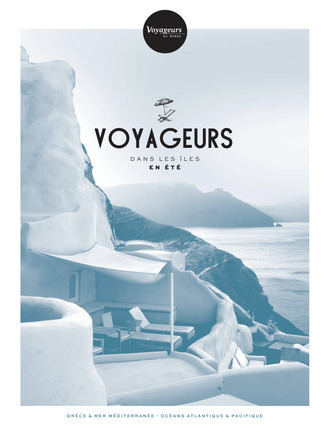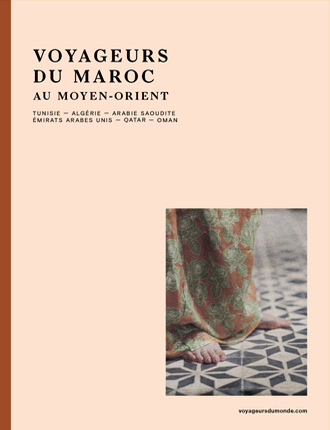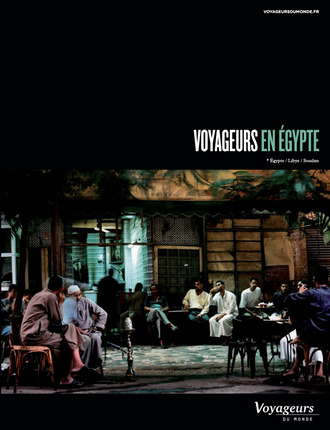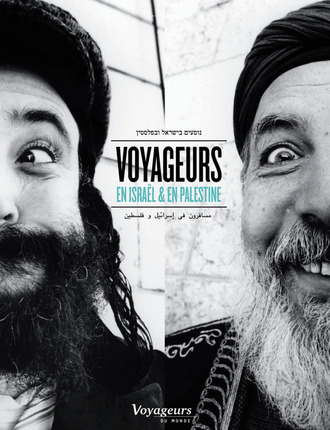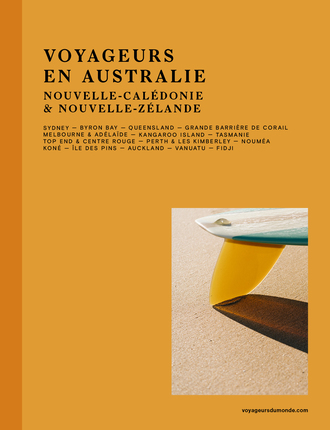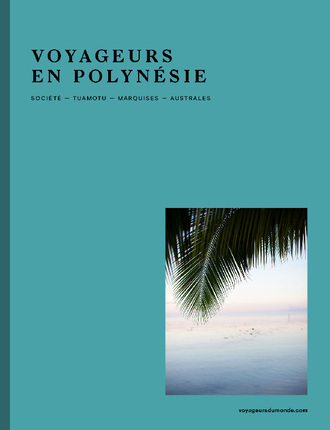Population
21 104 020, en 2025.
Langue officielle
L’anglais.
Langues parlées
Pour les Zambiens, l’anglais est une langue seconde : moins de 1% d’entre eux l’a pour langue maternelle et ils sont autour de 30% à le parler plus ou moins fluently. C’est néanmoins la langue véhiculaire du pays. Les langues traditionnelles zambiennes appartiennent à la famille bantoue. Elles sont une bonne soixantaine, mais la Constitution n’accorde de statut officiel qu’à sept d’entre elles : le bemba (26,6% de locuteurs), le kaondé (2,1%), le lozi (6,2%), le lunda (2,2%), le luvalé (1,7%), le nyanja (10,1%) et le tonga (13,4%). Ce sont les principaux idiomes des neuf provinces. L’enseignement primaire peut les utiliser. En dehors de l’anglais, les premières langues allogènes sont l’afrikaans, le chinois et le gujarati.
Peuples
Le nombre d’ethnies présentes sur le territoire zambien est équivalent à celui des langues. Les plus répandus sont les Bemba, nord-est et centre (où ils ont des cousins Lala-Bisa et Lamba). Les Tonga sont solidement établis dans les provinces sud et ouest. À l’ouest encore, les Lozi. À l’est, on rencontre les Nyanja. Et, dans la province de Lusaka, les Nsenga. Ces solidarités, que coiffent des pouvoirs traditionnels, ont toujours un rôle social important. Quelques milliers de Britanniques sont restés en Zambie après l’indépendance. Le pays a plus tard accueilli des gens quittant le Zimbabwe. Les uns et les autres vivent à Lusaka et dans le Copperbelt ; certains exploitent des terres agricoles dans le sud. Peu nombreux, mais influents, les Sud-Africains. Très présents dans le commerce et l’industrie manufacturière, les Indiens et les Chinois sont deux communautés qui comptent.
Religions
Aux termes de la Constitution, la Zambie est une nation chrétienne. De fait, il y aurait 75% de Zambiens protestants et 20% de catholiques à travers le pays. L’histoire a donné à ce christianisme, pris dans son ensemble, quelque chose de bigarré : si le catholicisme ne se différencie pas trop, les confessions réformées sont fort diversifiées. Les plus nombreux étant cependant les anglicans, les évangélistes et les pentecôtistes. Dans ce milieu chrétien, de nombreux éléments des croyances et des pratiques traditionnelles se sont adaptés et survivent.
Fête nationale
Le 24 octobre, anniversaire de l’Indépendance, 1964.
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
12 mars : jour de la Jeunesse.
Mars ou avril : Pâques, dont Vendredi saint.
1er mai : fête du travail.
25 mai : jour de l’Afrique.
3 juillet : jour des Héros.
5 juillet : fête de l’Unité.
6 août : Farmer’s Day.
24 octobre : fête nationale.
25 et 26 décembre : Noël.
Politique
La Zambie est une république, réglée, à la britannique, par la constitution de 1991. Le président est élu pour cinq ans au suffrage universel (scrutin uninominal à un tour). Chef de l’État et du gouvernement, il a les clés de l’exécutif. Le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et la National Assembly. Celle-ci, monocamérale, a 167 députés. 156 d’entre eux sont élus dans les circonscriptions pour un mandat de cinq ans ; 8 sont nommés par le président, pour des raisons de compétence spéciale ou d’équilibrage de genre ; 3 sont membres ex officio : le vice-président de la République, le président de l’Assemblée et son premier vice-président, tous deux élus par elle en dehors d’elle. Le système judiciaire comporte des juges de paix (local courts), des cours pénales (magistrate’s courts), une Haute Cour (High Court) et une Supreme Court, ultime instance d’appel. Une cour constitutionnelle a été établie en 2016.
Histoire
De l’histoire profonde, on ne sait encore pas grand-chose de certain. Lorsqu’ils arrivent, au IVe siècle, dans le bassin du Zambèze, les Bantous y rencontrent des San, qui chassent, cueillent et nomadisent. Ceux-là refoulent ou absorbent ceux-ci (qui ont laissé des traces pariétales de leur présence). Ils installent l’agriculture, la poterie, la métallurgie. Peu à peu, une civilisation du cuivre émerge. Et des entités sociales dont ce métal est la monnaie d’échange. Entre les XVIe et XVIIIe siècles, ce sont le Kazembe, dans le centre de la Zambie actuelle ; les Bemba, à l’est ; Lozi, au sud-ouest ; le royaume Lunda à l’ouest. Au XVIIIe siècle, les Portugais sont anxieux de lier entre elles leurs possessions d’Angola et du Mozambique. Les pombeiros, trafiquants d’esclaves parfois métisses, vont frayer des voies à travers ces contrées difficiles d’accès. En 1798, Francisco José de Lacerda e Almeida part de Tete, au Mozambique, et parvient à Kazembé, en pays Lunda. La malaria l’y tue. Il laisse un journal de route qui est longtemps le seul document disponible sur la région. Un demi-siècle plus tard, en 1855, David Livingstone atteint des chutes sur le Zambèze, qu’il nomme Victoria. L’explorateur écossais entre en contact avec le roi Sebetwane du Barotseland, en pays Lozi, sur le haut cours du Zambèze. Au terme d’une vingtaine d’années d’explorations épiques, il meurt (dysenterie et malaria) en 1873 au bord du lac Bangwelo.
En 1889, Cecil Rhodes, qui sera l’année suivante Premier ministre de la colonie du Cap, fonde la British South Africa Company, titulaire d’une charte royale et destinée à l’exploitation colonisation de territoires situés au nord du Limpopo. Les tensions entre Matabele et Barotse permettent à la Company de prendre pied au nord du Zambèze. Rhodes espère réunir le Nyassaland (actuel Malawi), son Haut-Zambèze et le Katanga congolais. En 1895, le Haut-Zambèze est partagé en Rhodésie du Nord-Ouest et Rhodésie du Nord-Est, la Rhodésie du Sud correspondant à l’actuel Zimbabwe. Le Prime Minister du Cap a inscrit son nom dans la géographie. Et mis la main sur les mines de cuivre du futur Copperbelt. Ce dynamisme impérial, qui ambitionne d’ouvrir son compas du Cap au Caire, se heurte à l’expansionnisme local des Bemba. Lesquels sont mis sous l’éteignoir. Brutalement. Au début du XXe siècle, la capitale de la Northern Rhodesia est établie à Livingstone et des frontières sont dessinées. Une administration est installée et les missionnaires anglicans déploient leurs dispensaires, leurs écoles et leurs églises.
En 1924, la Rhodésie du Nord devient un protectorat de l’Empire britannique. Administré par un conseil législatif, sous la direction d’un governor représentant le souverain. Cette instance s’articule aux chefferies traditionnelles, comme le royaume du Barotseland, par exemple. Un plafond de verre, constitué par les règles de désignation, interdit de facto aux Africains d’y entrer (à partir de 1938, ceux-ci auront un représentant Blanc). Ils sont refoulés dans des zones réservées, les terres les mieux exploitables – sol ou sous-sol – passant à la Couronne. La population blanche, très minoritaire, a une forte composante sud-africaine, attirée par de bonnes conditions faites aux colons. La ségrégation s’impose par les règlements, plus que par une politique concertée. Dans l’exploitation du cuivre notamment : au cours des années 30, la colonie agricole prend un tournant minier et industriel. L’Anglo American Corporation et le Rhodesian Selection Trust sont à la manœuvre. En 1935, la capitale est transférée à Lusaka. À cette époque, travailleurs noirs et blancs font valoir séparément leurs revendications. Un mouvement national africain s’esquisse.
Afin d’équilibrer l’économie, de contrebalancer une Afrique du Sud afrikaner et de diluer l’indépendantisme noir, le projet britannique de fédération des deux Rhodésie et du Nyassaland prend corps après la 2nde Guerre mondiale. Les Blancs de Rhodésie du Nord sont partagés : pour, une structure qui garantirait des liens organiques avec la Grande-Bretagne ; contre, une certaine méfiance à l’égard des ségrégationnistes du sud. Ceux de Rhodésie du Sud, le sont aussi : contre, le poids démographique des Africains du nord et du Nyassaland ; pour, une solution à leur endettement. Quant aux Noirs, ceux du nord s’inquiètent d’une administration plus ségrégationniste que celle du Colonial Office et tous soupçonnent, à juste titre, Londres de vouloir, par ce biais, garder la main. Un mélange millésimé d’opportunisme et d’idéalisme universaliste va prévaloir au bord de la Tamise. Un projet de constitution est avalisé par le parlement britannique en 1952. L’année suivante, le oui l’emporte en Rhodésie du Sud. La fédération est acceptée. La participation des Noirs à son administration (voire sa direction, à terme) est envisagée. Disons que, sans se volatiliser, le plafond de verre montre quelques fissures. La priorité est économique : développement industriel et agricole. La question énergétique est capitale. On envisage la création d’un énorme barrage hydroélectrique dans le bassin du Zambèze. Ce sera le Kariba Dam. Le militantisme noir se structure. Et tangue. À la suite de la compromission du leader nationaliste Harry Nkumbula (African National Congress) avec le parti pro-UK du premier ministre Roy Welensky, Kenneth Kaunda président de l’UNIP, le United National Independence Party, rompt l’alliance ANC / UNIP. En 1960, au moment de renouveler le pacte constitutionnel, les Blancs de Rhodésie du Sud refusent toute évolution. C’est l’impasse. L’UNIP plaide à Londres la fin de la fédération. Et remporte les élections générales de 1962 en Rhodésie du Nord. Le plafond de verre a sauté. Kaunda et Nkumbula sont aux manettes et réclament l’indépendance. Les Nations Unies suivent. Dans un premier temps, la Federation of Rhodesia and Nyasaland est dissoute. Et la Rhodésie du Nord revient dans le giron du Colonial Office. En 1964, Kaunda devient premier ministre. L’indépendance est a portée de main. C’est fait le 24 octobre. La Zambie est acquise.
Kenneth Kaunda va concentrer le pouvoir jusqu’en 1991. L’opposition de Nkumbula fait long feu. Le lendemain de l’indépendance est marqué par des conflits ethniques. Dans un pays assemblé au gré des visées coloniales, l’unité nationale n’est une évidence pour personne. Les particularismes se font valoir. On en vient rapidement au parti unique. Et, dans le cadre de la Guerre froide, au socialisme. Nationalisation de l’industrie, culture du maïs pilotée par l’État. La prospérité dépend des marchés extérieurs. Les exportations sont compliquées pour un pays enclavé, géographiquement et politiquement : il faut trouver en Tanzanie des issues bouchées en Rhodésie, ex-Rhodésie du Sud. Les investissements dans l’appareil productif sont insuffisants. Bref, de décennie en décennie, la situation économique se dégrade et celle des Zambiens. La condition qui leur est faite est indigne d’un potentiel considérable. L’État s’isole de la société. À l’extérieur, Kaunda ménage la chèvre et le chou dans un contexte épineux. Il soutient les mouvements d’émancipation, sans toutefois rompre avec l’Afrique du Sud. Par exemple. Il parvient à rester un interlocuteur pour tout le monde. Il n’est pas ubuesque. Pour autant, la Zambie est remontée contre son leader. Elle lui impose des élections et porte au pouvoir le patron du Movement for Multi-Party Democracy, Frederick Chiluba. Cet ancien syndicaliste marxiste suit les recommandations du FMI et met le pays sur la voie du libéralisme. Il est élu pour un second mandat en 1996. En 2001, il respecte les termes de la constitution et renonce à se représenter. Dans les années suivantes, plusieurs élections illustrent la viabilité de la démocratie zambienne.
Personnalités
Homo rhodesiensis a été découvert en 1921 à Kabwe, Central Province, mais sa présence sur le territoire zambien date d’entre 700 000 et 300 000 ans. Ascendant immédiat d’Homo sapiens ? Sans doute pas. Par contre, prédécesseur du même genre sur le terrain, sûrement. En tout cas, les Zambiens ont adopté ce vieux cousin. Au point de préférer qu’on l’appelle désormais Homme de Kabwe plutôt que rhodesiensis.
David Livingstone, 1813-1873. Pasteur, médecin, explorateur, cartographe, Livingstone est un héros victorien. On ne doutait pas alors du génie civilisateur européen, qui était tout à la fois religieux, moral, commercial, politique et athlétique. Le bonhomme mit un faisceau de compétences et de qualités au service de cette vision (en outre, dans son cas, abolitionniste de l’esclavage). Et puis, la réalité de la colonisation s’est montrée marâtre. Il a fallu envisager les choses autrement. Néanmoins, la performance exploratrice demeure. Et impressionne.
Harry Nkumbula, 1916-1983. C’est au long de son parcours de la Methodist mission school de son district natal de Namwala à la London School of Economics qu’Harry Nkumbula s’est formé au militantisme politique. Sa trajectoire est emblématique de temps troublés et incertains. S’il a contribué au gain de l’indépendance, il a perdu la bataille du pouvoir. Il n’en est pas moins une figure-clé du nationalisme zambien.
Sylvia Banda, née en 1962. Cette dame est une cheffe d’entreprise reconnue et la figure de son pays au African Women Entrepreneurship Program. Elle possède de nombreux restaurants à Lusaka et intervient tous azimuts dans les domaines agricole et alimentaire. Avec pour objectif la promotion d’une identité culinaire zambienne. Elle est aussi chroniqueuse cuisine au Times of Zambia.
Esther Phiri, née en 1987. Ceux qui lui achetaient des fruits et légumes dans les rues de Lusaka n’imaginaient sans doute pas à quel point la marchande des quatre saisons serait capable de mettre les poings sur le « i » de la Zambie. Quelques années plus tard, elle était championne du monde WIBA et IBO en super-légers. Une étoile avec des gants de boxe.
Amon Simutowe, né en 1982. La tête et les jambes. On est parfois condescendant envers les footballeurs. Et on a tort. Amon, par exemple, visait l’équipe nationale, les Chipolopolos ; mais, pour cela, il fallait laisser tomber l’échiquier. Impossible. Et à raison. En 2009, il devient le premier grand maître international d’échecs d’Afrique sub-saharienne.
Sampa Tembo, née en 1993. Sampa the Great accumule les récompenses en Australie, mais elle est née à Ndola dans le Copperbelt. Elle a gardé de ses origines zambienne et africaine une conscience aigüe. Dont elle nourrit sa musique. La Zambie a donc irrigué le rap international. Et, si ça ne rigole pas, ça groove.
Paul Dobson Nyirongo, né en 1949, Paul Ngozi. Ce sont les disques de James Brown et de Jimi Hendrix qui ont donné le top départ de l’aventure Zamrock. Lequel allait pendant dix ans associer héritage africain et guitare fuzz, avant que la rumba congolaise n’emporte tout. Paul Ngozi et la Ngozi Family – nerveux, mélodiques, colorés, sociaux – sont sans doute ce que le style de Lusaka a produit de plus durable.
Margret Chola, née en 1939. Cette vieille dame Bemba vit dans la cambrousse, au nord de Lusaka. Et puis, elle a une petite fille styliste à New York, Diana Kaumba. Laquelle est un jour rentrée au pays avec une pleine valise de tenues hype. Margret et Diana se sont plu à essayer tout ça et à poster les photos de Mbuya ainsi métamorphosée. Classe. Instagram a fait le reste.
Doreen Malambo. L’inspecteur-chef Doreen Malambo s’est vu décerner en 2020 le prix de la Femme policière de l’ONU pour son travail au Soudan du Sud. Engagée dans l’opération de maintien de la paix, la policière zambienne s’est distinguée par la qualité particulière de sa contribution du programme Femmes, paix et sécurité. Un féminisme conséquent, où on ne l’attendait peut-être pas.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
Pour les chauffeurs, nous vous conseillons, au minimum, l’équivalent de 4 euros par jour et par personne. Le double pour les guides.
En ce qui concerne le personnel local - serveurs, porteurs, etc. - les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Comme partout en Afrique, une tenue convenable est appréciée.
Cuisine
Peu de saveur, peu de vertus nutritives, nshima n’en est pas moins distinctive de la cuisine zambienne, son support. Farine de maïs blanc, ou de manioc, cuite à l’eau, elle se présente sous la forme d’un bloc laiteux, sans qualités. Elle occupe le terrain et l’estomac ; elle vaut par ce qui l’accompagne. Relish ou ragoût. Ifisashi, par exemple, où entrent des arachides, des oignons et des feuilles de citrouille, patate douce, betterave, moutarde, etc. On peut y ajouter une viande. Le samp, grains de maïs battus et décortiqués, est mangé avec du lait fermenté et du sucre par les Lozi. On le consomme aussi toutefois avec le bœuf, l’agneau la pintade ou le poulet. Il est utilisé dans les farces. Il faut relever que l’importance prise par le maïs est récente (seconde moitié du XXe siècle). Auparavant, la céréale utilisée, par les Bemba notamment, était le millet. Légumes et fruits sont abondants. Parmi les premiers, on note la fréquence des gombos et des légumes feuilles : courge, manioc, amarante, aubergine amère, hibiscus, etc. Les nombreux lacs du pays procurent du poisson, que l’on accommode comme les viandes, marmite ou grill. À ce dernier propos, il est à noter que le braai, le barbecue sud-africain, a sa version zambienne.
Street food : on les attrape dans le lac Tanganyika, on les fait sécher, on les fume éventuellement : les sardines du Tanganyika font une délicieuse friture qui se trouve partout en Zambie. Chikanda est une préparation d’origine Bemba. Elle est faite de tubercule d’orchidée, de cacahuètes, piment, épices, mélange levé que l’on peut servir en tranches ou découpé en bouchées. Très répandu également. Seize orchidées sont aptes à sa préparation. Les beignets puff-puff sont tout simples. Tute ne mbalala, manioc et cacahuètes, est un duo grignotage des plus classiques. Et les samossas marquent l’influence indienne. Les gésiers sont appréciés, mais aussi les vers mopane (qui sont autrement énergétiques que nshima). Pour un en-cas sucré, maandazi est épatant. Ce sont de petits beignets, legs de la côte swahilie.
Boisson
L’eau du robinet étant impropre à la consommation, on boit de l’eau minérale en bouteille (capsulée). Ou des sodas. Ou de la bière : Zambian Breweries vous le permet. Il est logique d’éviter les glaçons. On retrouve le maïs dans les verres : munkoyo et maheu, deux breuvages traditionnels fermentés, ont une base de farine de maïs (avec racine d’Eminia, du genre glycine, dans le premier cas). Dans l’est, avec thobwa, bu froid ou chaud, on conserve le millet (éventuellement remplacé par du sorgho). Chibuku et Shake-Shake sont des bières de maïs modernes.