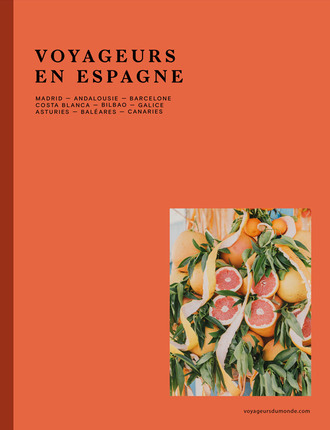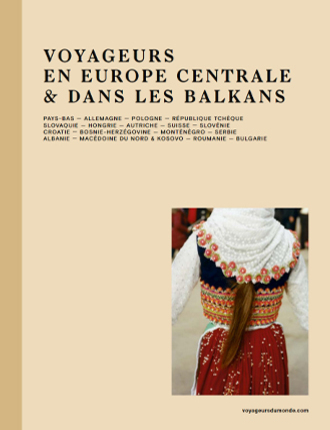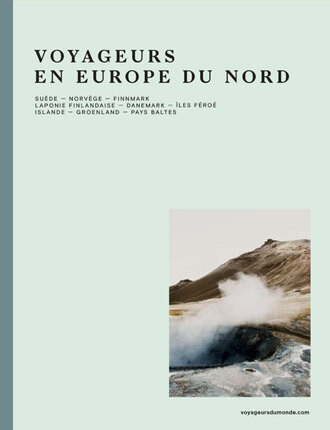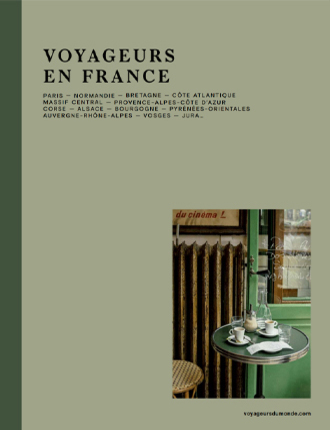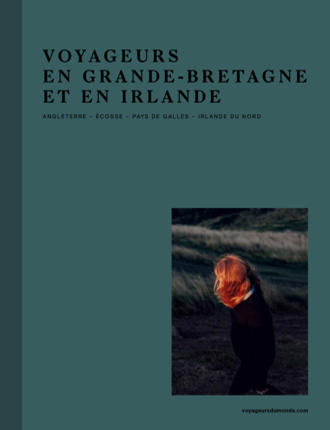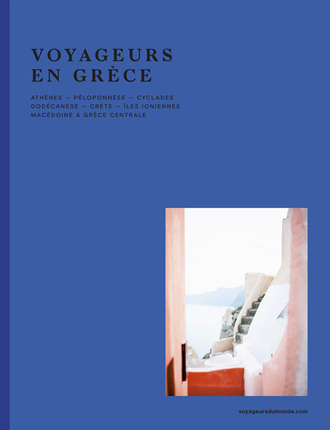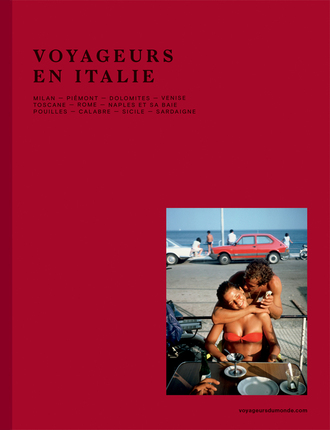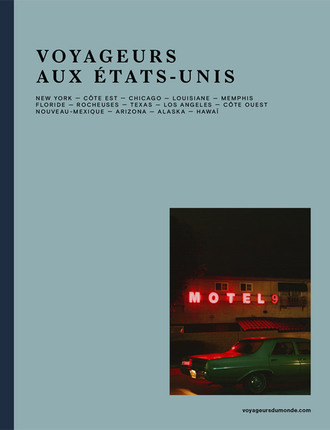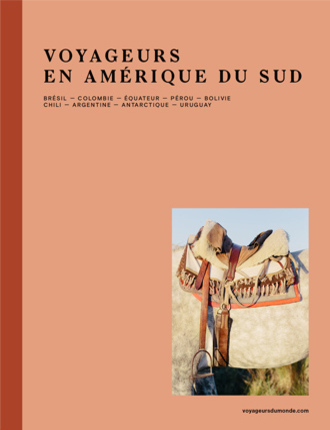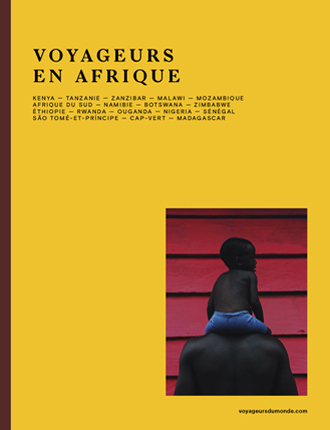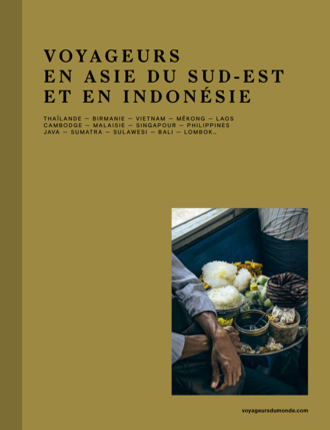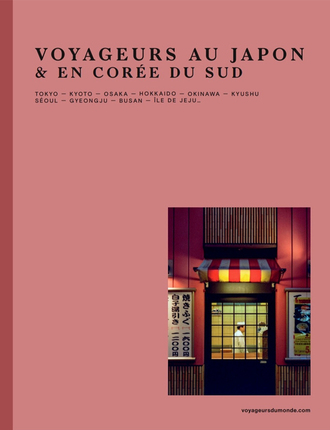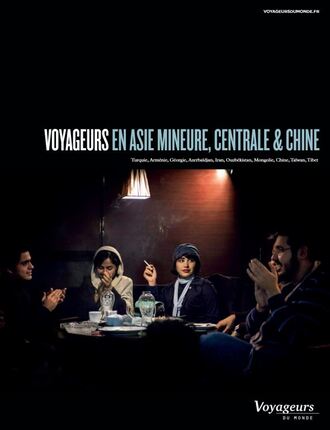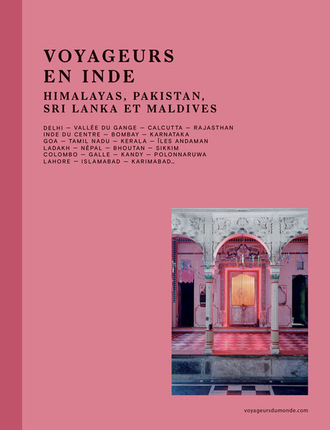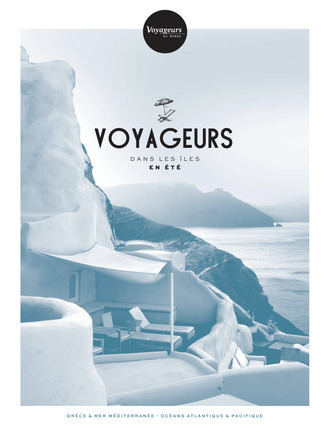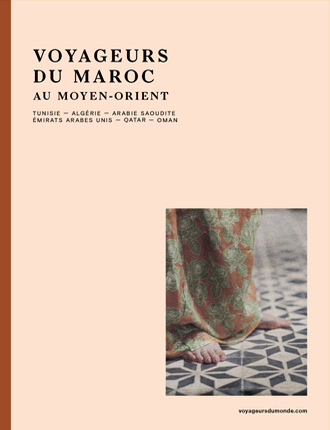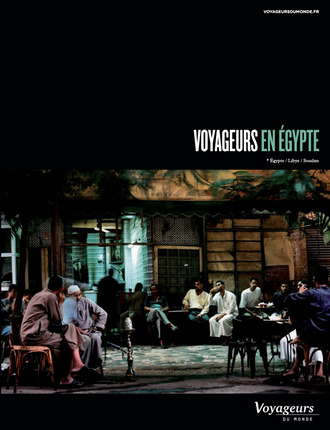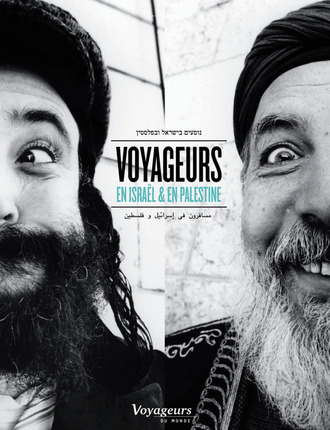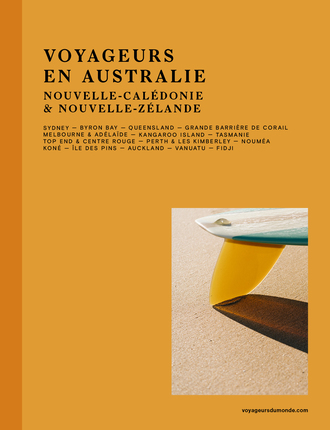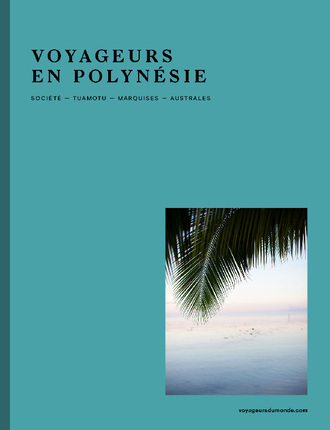Population
11 217 467, en 2025.
Langue officielle
Arabe classique.
Langues parlées
Les arabophones sont près de 60% de la population. Ils parlent l’arabe du Golfe, l’arabe hijazi, omanais, égyptien, levantin, soudanais, etc. Comme ailleurs, l’arabe classique leur sert de langue véhiculaire et écrite ; l’État parle l’arabe du Golfe. Pour les autres, c’est l’anglais qui tient le rôle de lingua franca. Les premières langues étrangères sont le malayalam (11,4% des locuteurs / Kerala) ; le télougou (4,9% / Inde méridionale) ; le baloutchi (4% / Baloutchistan) ; le pachto (4% / Pakistan et Afghanistan). L’anglais est donc partout pratiqué au moins un peu.
Peuples
Les populations d’origine – Arabes du Golfe, Bédouins – ne représentent plus que 40% de la population. En prenant en compte tous les Arabes présents dans le pays, on monte à environ 60%. Les 40% restant sont constitués par d’autres travailleurs immigrés que les quelque 20% arabes, des ouvriers non qualifiés aux ingénieurs et aux cadres sup’. Ils sont nombreux à venir du sous-continent indien : Malayalee, Télougous, Bangladeshis, Penjabis, etc. D’autres sont Indo-Iraniens : Baloutches, Pachtounes, Iraniens. Philippins, Somalis ou Chinois s’y ajoutent. Ainsi que nombre d’Européens et de Nord-Américains.
Religions
On peut estimer que 77% des résidents dans les Émirats sont musulmans, majoritairement sunnites. Les chiites seraient moins de 10%. Les 9% de chrétiens, 5% d’hindous, 5% de bouddhistes appartiennent aux groupes étrangers. Lesquels peuvent pratiquer leur religion dans un cadre strict, tout prosélytisme étant exclu. Il y a une cinquantaine d’églises chrétiennes dans les EAU. Et une synagogue, à Dubaï ; dans l’ombre de la question israélo-palestinienne. La General Authority of Islamic Affairs and Endowments contrôle les mosquées sunnites à l’échelon fédéral – les moquées dubaïotes relevant elles du Islamic Affairs and Charitable Activities Department. Ces organismes fournissent notamment les thèmes des sermons du vendredi et des services de gestion et de soutien des activités charitables, des avis sur les questions de droit religieux.
Fête nationale
2 décembre : création de la Fédération, en 1971.
Calendrier des fêtes
1er janvier : jour de l’an.
1er décembre : journée de commémoration des morts pour la liberté des Émirats.
2 et 3 décembre : fête nationale.
L’islam procure néanmoins aux Émiratis leurs fêtes majeures : Eid al-Fitr (fin du ramadan) ; jour de l’Arafat (fin du pèlerinage à La Mecque) ; Eid al-Adha (fête du sacrifice) ; nouvel an héjirien (lunaire) ; anniversaire du Prophète. Elles sont mobiles par rapport au calendrier grégorien.
Politique
La constitution de 1971, définitivement adoptée en 1996, règle la vie politique des Émirats arabes unis. Au niveau fédéral – qui concerne les affaires étrangères, la défense, l’éducation, la santé publique, la monnaie, etc. – le système politique est coiffé par le Conseil suprême réunissant les sept émirs. Celui d’Abou Dabi assurant la présidence et celui de Dubaï la vice-présidence et la fonction de premier ministre. Le Conseil dispose donc du pouvoir exécutif fédéral (chacun des émirs conservant des prérogatives locales). Il a aussi l’initiative dans le domaine législatif. Néanmoins, les lois sont examinées par une entité consultative, le Conseil national fédéral, dont les 40 membres viennent de tous les Émirats. Leur nombre et leur mode de désignation sont en cours de réforme. La charia inspire le droit. Le système judiciaire est à deux niveaux, des tribunaux de première instance et une Cour suprême qui fait fonction de cour d’appel (Dubaï et Ras al-Khaïma ont leur propre juridiction d’appel). Les tribunaux islamiques ont à connaître ce qui relève du statut personnel des musulmans.
Histoire
Antiquité
Les premières traces de présence humaine dans les Émirats datent d’il y a 125 000 ans. La nature des artefacts semble indiquer que, lors de leur sortie d’Afrique, les hommes modernes sont passés par là. Les variations climatiques ont ensuite alternativement permis et interdit les activités humaines dans la région. Aux Ve-IVe millénaires, la Mésopotamie entretenait des relations commerciales avec les mineurs et les fondeurs de bronze du Magan (Oman et EAU actuels). Après un blackout archéologique, apparaissent dans le Jebel Hafeet et ailleurs, les établissements et les tombes Hafit, 3100-2700. Les relations avec la Mésopotamie (et la vallée de l’Indus) se poursuivent. Ainsi aussi durant les périodes suivantes : Umm Al Nar (2600-2000) et Wadi Suq (2000-1300). Au cours de cette dernière, deux domestications clés, le dromadaire et le palmier dattier. L’un et l’autre ouvrent l’arrière-pays désertique. Pendant l’Âge du fer, jusqu’en 300 avant notre ère, l’agriculture se développe autour de sites fortifiés grâce à la maîtrise de l’irrigation par qanat (puits reliés par une galerie-drain). En voisine entreprenante, la Perse sonde la région. Saruq Al Hadid – proto-Dubaï – est alors un grand centre métallurgique. Ensuite, Mleiha (Sharjah) semble être monté en gamme et avoir contrôlé au moins une partie de l’est des EAU et Oman. Architecture monumentale, influence hellénistique, commerce au long cours : une puissance régionale.
Islam, perles et flibustiers
Les choses vont leur cours régulier sur les routes commerciales entre la péninsule arabique et l’Asie du Sud. Jusqu’à l’évènement Mahomet. À la mort de celui-ci, en 632, les guerres d’Apostasie, menées par le calife Abou Bakr, vont donner la péninsule à l’islam. L’une des batailles décisives à lieu à Dibba (sur le golfe d’Oman) : l’armée de Médine bat celle du chef rebelle Laquit bin Malik, de la tribu des Azd. Par la suite, le port de Julfar (Ras al-Khaïma) devient un pivot du commerce des perles dans l’océan Indien. Dans un cadre fiscal imposé, à partir du XIe siècle, par le royaume d’Ormuz. Les sites de collecte se succèdent tout le long du littoral, depuis Doha. La Grande Plongée, juin septembre, s’effectuait au départ de Dalma. Autour des perles, une société tout entière s’était organisée. Et sa richesse dépendait des mollusques. Ce qui devait attirer les navigateurs portugais. En 1515, ils se saisissent d’Ormuz (et de la fiscalité perlière). Ils peuvent en profiter un siècle. Le shah Abbas 1er le Grand les chasse du golfe Persique en 1622. Les Anglais ont favorisé l’opération. Les Al Qasimi, installés à Sharjah et Ras al-Khaïma, disputent aux Omanais les eaux du détroit et du golfe. Qui deviennent la Pirate Coast. Le premier État saoudien, l’émirat de Dariya (1744-1818), prend la main dans la région. Le plus célèbre pirate de l’époque fut Rahmah ibn Jabir al-Jalhami, un flibustier audacieux sans peur ni pitié. Il devait, selon l’ordre de ses intérêts, s’allier aux Wahhabites, aux Omanais ou aux Britanniques. Pendant ce temps, les Bani Yas règnent sur Liwa. Ils vont installer l’une de leurs branches, les Al Nahyan, à Abou Dabi en 1790. En 1833, une autre à Dubaï, les Al Maktoum. Les actuelles familles régnantes viennent aux manettes.
Les États de la Trêve
En 1809, les Britanniques décident d’en finir avec la Pirate Coast. Ils mettent Ras al-Khaïma à sac. Le traité qui sort des flammes procure six ans d’apaisement, puis les abordages reprennent de plus belle. Retour en force des Britanniques en 1819. Ils démantèlent fortifications et flottes – à Ras al-Khaïma, Umm al-Qaïwaïn, Sharjah, Abu Hail, Dubaï, Ajman – et ramènent les cheikhs côtiers à la table de négociation : General Maritime Treaty de 1820. Pour le coup, on se calme. Le General Treaty est suivi en 1853 par la Perpetual Maritime Truce. Des textes additionnels prohibant la traite des esclaves et garantissant le télégraphe. En fin de compte, les États de la Trêve voient leurs activités maritimes et diplomatiques mises sous tutelle, mais pas leurs affaires internes. La géométrie de ce dispositif a un peu varié avant qu’il devienne les Émirats arabes unis. Fujaïra, par exemple, ne l’a rejoint qu’en 1952. Et Kalba, reconnu à partir de 1936, est désormais intégré à Sharjah. Les Britanniques souhaitaient naviguer en paix. Ceci obtenu, ils laissèrent donc les cheikhs régler entre eux leurs différends. Jusqu’à ce que…
Le pétrole et l’indépendance
… du pétrole soit découvert en mer et dans le désert. Des missions de prospection avaient été menées dès les années 1930. Des gisements sont identifiés à Umm Shaif (off-shore) en 1958, et à Murban en 1960. En 1962, une première cargaison de brut quitte Abou Dabi. Londres tente alors de resserrer les boulons. Devant les perspectives ouvertes, les cheikhs des États de la Trêve forment un conseil – dans l’esprit des traités, leurs affaires les regardent – et les compagnies pétrolières américaines déboulent. La Grande-Bretagne est dépassée. De 1966 à 1971, les décisions de retrait sont prises. En dépit (et à cause) d’inquiétudes à propos de la stabilité régionale, Abou Dabi et Dubaï proposent la fédération de neuf émirats : ceux de la Trucial Coast, du Bahreïn et du Qatar. Le scheik Zayed bin Sultan Al Nahyan d’Abou Dabi est placé à la tête du projet. Rapidement, Bahreïn et le Qatar prennent leurs distances. En 1971, l’Iran occupe les îles Abou Moussa, Grande et Petite Tunb. Le 1er décembre de la même année, les traités liant la Grande-Bretagne aux Trucial States expirent. Le 2, Ajman, Sharjah, Umm al-Qaïwaïn et Fujaïra fondent avec Abou Dabi et Dubaï les Émirats arabes unis. Une tentative de révolution de palais à Sharjah en janvier 1972 fut un premier test de la solidité politique de la nouvelle fédération. Laquelle mobilise et règle la question manu militari. Du coup, le mois suivant, Ras al-Khaïma, qui avait pourtant soutenu le putsch, rejoint les EAU.
Le pétrole et l’après-pétrole
Les revenus générés par les hydrocarbures donnent aux Émirats les moyens d’un décollage spectaculaire dans tous les domaines : économie, santé, éducation, culture, télécommunications. Après le 11 septembre 2001, ils sont contraints de donner des gages à l’Amérique et soutiennent les interventions en Afghanistan et en Irak. L’US Air Force et l’Armée de l’air française rejoignent l’Armée de l’air émiratie sur la base d’Al Dhafra à Abou Dabi. La modernisation va grand train. Les travailleurs de toutes natures affluent. L’ancienne société ne disparait pas pour autant. Elle reste la trame de la vie sociale et politique. Les remuements de l’islam contemporain passent par les EAU. On engage une aventure spatiale, en direction de la Lune et de Mars. Le printemps arabe se solde en un procès. Les Frères musulmans sont combattus. La base des relations internationales est considérablement élargie. La fin du pétrole est envisagée avec sérieux. Les Émirats veulent compter dans un avenir forcément mondialisé. L’adoption du week-end samedi-dimanche, par exemple, est un signe, qui les cale sur le régime général.
Personnalités
Burj Khalifa, 2010. Cette tour de Downtown Dubai, haute de 828 mètres, la plus haute du monde à ce jour, est sans doute la célébrité émirienne. Celle qui manifeste avec la plus grande évidence le nouveau statut des EAU. Et leur volonté de s’inscrire sur le planisphère en vertige contemporain. Prouesse financière et technique, ce colosse effilé pointe vers le ciel comme, en définitive, un point d’exclamation.
Ahmad Ibn Madjid, 1432-1500, né à Ras al-Khaïma, fut l’un des grands navigateurs de son temps. Et pas un simple capitaine, mais aussi un homme de lettres et un savant. Son ouvrage principal, le Livre des informations utiles sur les principes et les règles de la navigation, a fait date. On lui doit aussi des instructions détaillées sur le golfe Persique, l’océan Indien, la mer Rouge, la mer de Chine.
Hamdan ben Mohammed Al Maktoum, né en 1982 à Dubaï. Dans la famille Al Maktoum, je voudrais le poète. Car le prince héritier de l’émirat publie sous le nom de plume de Fazza. Formé à l’académie militaire de Sandhurst et à la London School of Economics, il ne faut pas voir en lui une cigale qui aurait oublié d’être fourmi. Ses responsabilités présentes et futures donnent à sa muse un poids.
Lubna Khalid Al Qasimi, née en 1962 à Dubaï. Elle est la première femme à exercer des responsabilités ministérielles aux EAU. Actuellement ministre de la tolérance, elle le fut aussi de l’économie et du plan, ainsi que du commerce extérieur. Une carrière managériale et politique qui a accompagné le mouvement de libéralisation prudente mais certaine de la société émiratie.
Mariam al-Mansouri, née en 1979 à Abou Dabi. Une femme aux commandes d’un F16 Falcon, engagée dans des missions de guerre contre l’État islamique en Syrie, était à la fois une première pour les Émirats et une formidable occasion de communication. On a pu trouver que Lady Liberty était un peu surjouée par les autorités, il n’en demeure pas moins que, dans son secteur, elle indique des possibilités nouvelles.
Balqees, née en 1984 de parents yéménites, n’en a pas moins son étoile sur la promenade des Dubai Stars de Downtown Dubai et son effigie de cire au musée Madame Tussauds de l’émirat. Elle inscrit les EAU sur la carte pop mondiale, avec les ambigüités et la flamboyance qu’autorise la Weltanschauung émirienne. Tout cela peut sembler futile mais, dans le monde des réseaux sociaux, la futilité a son importance.
Hazza Al Mansouri, né en 1983 à Abou Dabi, est un pilote de chasse de l’United Arab Emirates Air Force. Il y en a d’autres, mais il est le premier à être aussi cosmonaute. Du 25 septembre au 3 octobre 2019, il séjourne dans la Station spatiale internationale. Ce qui en fait un emblème des ambitions de son pays. Depuis, sa doublure, Sultan Al Neyadi, a lui aussi séjourné dans l’ISS.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant.
Le voile n’est imposé aux visiteuses que pour les visites de mosquée. Comme dans les enceintes religieuses, bras et jambes doivent être couverts dans certains bâtiments publics : hôtels de ville, tribunaux, etc. En tout lieu, il faut se montrer décent. Durant le ramadan, on évite de boire ou manger en public pendant la journée (certains bars et restaurants reçoivent néanmoins ceux qui ne jeûnent pas). Cette période voit aussi les plages d’ouverture des magasins, administrations, etc., restreintes.
L’utilisation de drone est soumise à l’autorisation préalable des autorités locales.
On ne photographie personne sans autorisation explicite.
Les marques d’affection en public sont interdites.
Cuisine
À Dubaï ou Abou Dabi, on trouve les cuisines du village global. Les restaurants sont à foison et proposent, sinon toutes les cuisines du monde, du moins toutes les plus fameuses (et quelques autres). De façon assez paradoxale pour le visiteur, les enseignes Arabic ne servent pas tant de la cuisine émirienne qu’une sélection standard de plats orientaux sur une base libanaise. Ce qui n’a rien à voir, même si le Liban s’est un peu annexé gustativement les EAU. Enfin, la cuisine traditionnelle des Émirats existe. Un peu nostalgique du fait des changements radicaux qui ont affecté la vie des gens d’ici. Elle reflète une position géographique entre mer et désert. L’héritage bédouin y est sensible. Alors, logiquement, les poissons sont très présents, mais aussi le mouton et le dromadaire. Avec ça, des céréales, des légumes, des dattes. Et beaucoup d’épices : safran, clou de girofle, cannelle, thym, curcuma, sumac, etc. Le citron séché entre dans de nombreuses préparations, parmi lesquelles jasheed, requin au riz, ou majbos, cuisiné avec du poisson, du poulet ou du mouton. Madrouba – au poisson séché, puis réhydraté et revenu au beurre clarifié – a le statut de plat national. Le dromadaire se rencontre sous forme de burger ; il peut surtout constituer la viande du ghoozi, plat de célébration. Un mets sucré ? Khabees, gruau de farine grillée au miel et aux épices.
Street food : le cosmopolitisme de l’offre ne laisse personne sur sa faim, mais le shawarma est sans doute ce que l’on mange le plus sur le pouce.
Boissons
Le café est la boisson sociale n°1 : pas de rencontre sans café ! Ghahwa, il est préparé à la cardamome et sucré. Rituellement, l’hôte boit une première (petite) tasse, puis l’invité deux (après quoi, il arrête s’il ne veut pas se montrer incivil). Si elle est consommable, l’eau du robinet ne laisse pas ignorer qu’elle est issue d’un processus de désalinisation. Heureusement, on trouve partout de l’eau minérale en bouteille. Les jus de fruit, en revanche, sont excellents. On boit aussi du thé aux épices. Et du jellab (mélasse et eau de rose). Ou du laban.
Les établissements autorisés – hôtels et restaurants – peuvent vendre de l’alcool aux non musulmans de plus de 21 ans. L’ébriété publique est un délit.