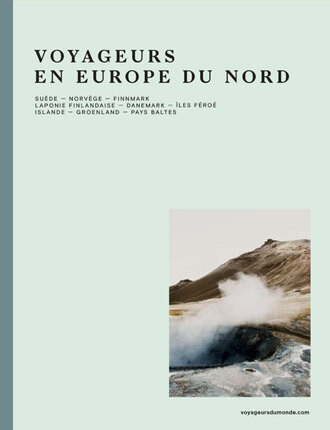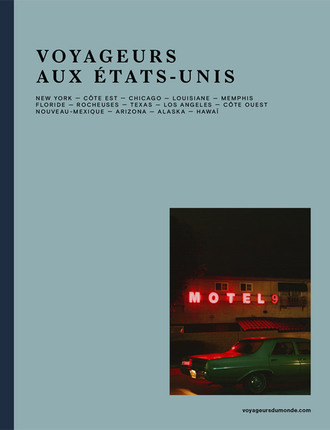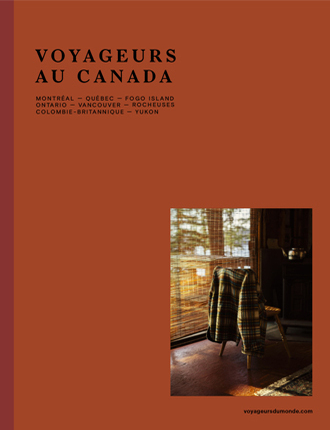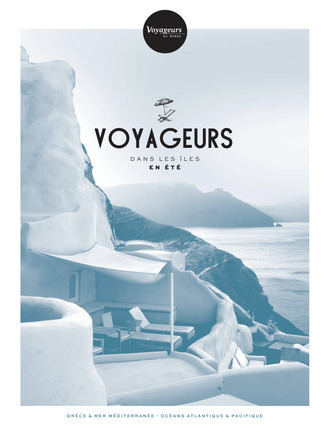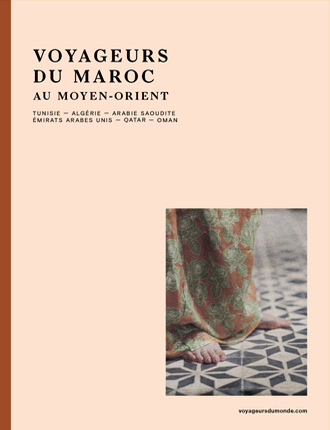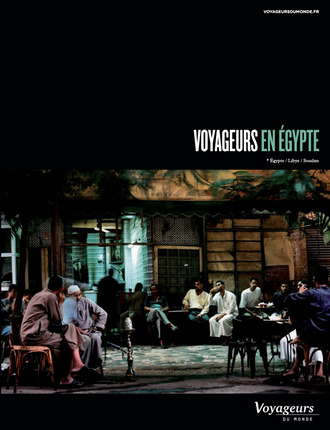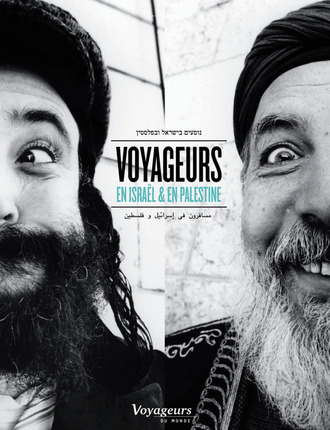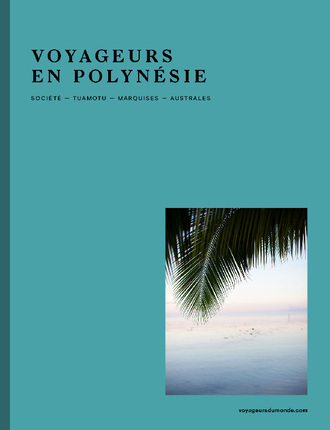“En Patagonie, celui qui se dépêche perd son temps…”, dit une expression chilienne. La devise pourrait s’appliquer au pays tout entier. Ainsi Voyageurs du Monde s’est imposé l’exercice : prendre le temps chilien et explorer cette bande de terre longiligne courant du nord au sud, du désert d’Atacama à la Terre de Feu, sur plus de 4 000 kilomètres.
Partir de l’océan, puis glisser vers l’extrême-sud : un voyage en deux escales qui incarnent, chacune à sa façon, le caractère du Chili. Tout d’abord, l’archipel de Chiloé, dont les éléments (sur)naturels, légendes, croyances et superstitions tissent en filigrane la singularité. Puis, Torres del Paine et les cimes de la Patagonie chilienne, spectaculaires. Un territoire qui prolonge l’escale précédente pour vite s’en détacher – le panorama y est plus sauvage encore, la présence humaine moins réelle. Les lignes dessinées par les caprices de la nature sont aussi celles d’un Chili poétique, celui de Pablo Neruda ou de Luis Sepúlveda… Récit d’une fugue dans ce “Monde du bout du monde”.

Une lettre et une fine bande d’océan séparent Chiloé du reste du pays. De Santiago, c’est d’abord l’envol jusqu’à Puerto Montt, avant d’emprunter en bateau le canal de Chacao. À l’arrivée à Isla Grande, la plus grande île de Chiloé (100 kilomètres du nord au sud), le paysage est tout entier plongé dans l’obscurité. Comme la terra incognita dort, on se plaît à en imaginer les pentes douces, au contact de cette route qui se courbe, s’élève progressivement dans les airs et redescend, prend à gauche sur un chemin de piste façonné par les éléments comme autant d’étapes naturelles à franchir. Au matin, la vallée apparaît. La baie est calme. La lumière se farde de rose, les nuages s’effacent, se fondent avec l’eau, jouent avec les contours du rivage. Les couleurs ne cessent de changer à mesure que les heures passent. Sans éprouver les éléments, on les devine : la brume des premières heures du jour, les quelques gouttes de pluie froide, la danse du vent et les ondulations de l’océan. Hypnotisante Pachamama, la Terre-Mère.

Nous prenons contact avec la Patagonie chilienne par le large. Par l’archipel de Chiloé, au nord, qui pique le Pacifique de plusieurs pointillés d’îles que l’écrivain chilote Francisco Coloane surnommait “les 40 sœurs”. Le bateau jaune et bleu est amarré. Il s’appelle Williche, en hommage à l’une des communautés indiennes natives de Chiloé. À bord de cette cabane de bois glissant sur l’eau, le large dévoile un tout autre spectacle, où les derniers manchots de Magellan se dirigent vers la Terre de Feu, les pélicans volent au ras de l’eau et, au loin, des dauphins agitent la surface d’un léger clapotis. Quelques embarcations de bois peint filent sans bruit.

Nous nous amarrons au quai de Mechuque où, au détour de maisons aux bardeaux fanés, l’île semble prise au piège du temps. Son isolement géographique a forcé certains habitants à partir – mais beaucoup n’ont pas vendu leurs maisons. L’attachement à ce bout d’île est trop fort pour être rompu. On se sent chilote avant d’être chilien. La végétation s’est emparée des maisons abandonnées. Un horizon que Sandro, pêcheur rencontré dans le village, ne quitterait des yeux pour rien au monde : “Je suis venu de San Antonio et je ne suis jamais reparti. Les gens ne savent pas ce qu’ils ont à Mechuque. La tranquillité… C’est ce qui me tient ici.” De sa maison, un petit palafito (maison typique en bois, sur pilotis) qu’il a construit lui-même après l’avoir vu en rêve, l’océan est le seul voisin.

Le bois d’alerce, matière première reine de Chiloé
On emporte ses paroles avec nous à bord du Williche. Le bateau est l’expression d’un art chilote, celui des charpentiers de l’île, les “carpinteros de ribera”. Il ne reste à Chiloé que dix ateliers de construction de bateaux. À la tête de l’un d’eux, David Pachuque répète depuis ses 15 ans les gestes appris de son père et de son grand-père. Dans son atelier sur pilotis, un hangar ouvert aux vents, trois bateaux en devenir, châssis de bois aux proportions magistrales. Il les a construits en suivant le tracé de courbes esquissées dans sa tête, songeant à la façon dont chaque bateau fendrait les flots.
Où le savoir-faire vit et se transmet par le geste, la science paraît artificielle. David pointe du doigt sa dernière réalisation, un bateau destiné à assurer la liaison entre les îles de l’archipel de Chiloé, comme un trait d’union entre ces pointillés de terre isolés les uns des autres. Le bois d’alerce est la seule matière première de Chiloé. Il raconte l’Histoire et les histoires de l’île. Celle de la centaine d’églises construites sous l’occupation catholique espagnole, durant les XVIIe et XVIIIe siècles.

Aujourd’hui, seize d’entre elles sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Colorées, elles sont entièrement en bois (même les clous ont été remplacés par des chevilles de bois). Autre élément-signature : les nefs centrales en forme de coque de bateau renversée. Et regardent toutes en direction du large. À Chiloé, le dialogue entre océan et spiritualité se tisse jusque dans les détails : dans l’église de Nercón, des bateaux-mobiles voguant dans les airs réalisés par des pêcheurs ont été installés là en guise d’offrande.

De bois aussi, les palafitos formant une ligne irrégulière à l’entrée de Castro, la capitale de l’archipel. Les voilà perchés sur la rive, entre la terre et l’eau – ni vraiment sur l’une, ni vraiment sur l’autre, accessibles par les deux. Comme les églises, les maisons de Chiloé, comme sorties d’un fi lm en Technicolor, se jouent du nuancier naturel de l’île. À les regarder de plus près, un élément intrigue. Certaines ont une petite porte au premier étage : “C’est une façon de dire aux sorcières qu’elles sont les bienvenues”, nous raconte-t-on. La superstition est partout, diffuse, ancrée dans les mœurs. Résumée en une phrase populaire qui révèle l’esprit de l’île : “Je ne crois pas aux sorcières, mais… est-ce qu’elles volent ? – Bien sûr que oui.”

Car Chiloé abrite une faune mythologique peuplée de créatures venant des forêts et des mers, où même les navires sont fantômes. L’écrivaine chilienne Isabel Allende l’évoque dans son roman Le Cahier de Maya : "Chiloé a sa propre voix. (…) Le vent, la pluie, le crépitement des bûches (…) et, parfois, les violons lointains du Caleuche, un bateau fantôme qui navigue dans la brume et qu’on reconnaît à sa musique." Sur la côte ouest de l’île, face au Pacifique, Marcello Orellana, artiste-sculpteur lui aussi chilien, a donné corps à cette légende. Construit en 2005, le Muelle del alma (le “Pont des âmes”) est un ponton de bois qui serpente de la terre à l’océan. Il marque l’endroit exact, à Punta Pirulil, où les âmes attendent le bateau qui les conduira vers l’au-delà.

Quittant l’océan et Chiloé, le voyage se poursuit vers l’extrême sud du pays, pour rejoindre le cœur de la Patagonie chilienne, sur les pas de Francisco Coloane (son tout premier voyage le fit regagner Punta Arenas au terme d’un périple de 2 000 kilomètres). Après l’atterrissage, notre voiture se lance sur la “route de la fin du monde”. À voir les kilomètres de steppes qui s’étirent et s’allongent, indifférents à la perte de repères qu’ils provoquent, le nom fait écho… Cette Patagonie dont les images défilent prolonge l’escale précédente pour vite s’en détacher : ici, la nature est souveraine, et la présence humaine se fait très rare.

Et la steppe patagonienne prend vie…
Quelque 300 kilomètres de ligne droite plus tard, le moteur s’arrête. Si loin de tout que l’on ne distingue plus rien de familier. Le matin, les premiers rayons de soleil s’emparent d’un paysage à la physionomie intimidante : une terre sèche, semée de ronces noueuses et de petits buissons. Derrière, quelques collines aux angles effacés par les années et le vent. Et, tranchant avec tout le reste, le massif de Torres del Paine : trois immenses sommets qu’on croirait tracés à la pointe fine. Ils font partie de la cordillère del Paine, dont la formation remonte à plusieurs millions d’années. Une partie seulement de la Cordillère s’élève dans le parc naturel de Torres del Paine, créé en 1958 et couvrant environ 240 000 hectares. À l’image du vertige des chiffres, aborder ce parc exige de se défaire de ses repères, de les laisser glisser dans l’infinité de la steppe. À mesure que l’œil s’habitue à l’épaisseur de l’obscurité et s’empare des kilomètres de cette terre sèche battue par les vents, petit à petit les contours et les reliefs se dessinent, les couleurs se nuancent.

La steppe patagonienne enfin prend vie, quelques guanacos (camélidés sauvages apparentés au lama) s’y déplacent, rapidement suivis par leurs petits. Cette terre est marbrée de lacs et lagunes formées par l’érosion, qui rappellent en couleurs qu’il y a 12 000 ans, les glaciers couvraient toute la région. Le glacier Grey en témoigne qui, surplombant le paysage, semble veiller sur lui. La pluie se déclare et donne à la contemplation un tour nostalgique. L’air de chamamé crépitant, musique folklorique qui s’échappe de la radio de la voiture, n’y est pas étranger. Ce morceau vient de Puerto Natales, aux abords de la frontière avec l’Argentine, à une vingtaine de kilomètres.

Au dehors, l’herbe s’avance et danse sur une lagune, un sommet enneigé se détache de l’horizon et dévoile, sous une fine couche de nuages, des arbres rougis par l’automne. Partout, le silence règne comme un écho aux paroles de Luis Sepúlveda dans le récit de ses aventures patagoniennes, Dernières nouvelles du Sud : “La steppe patagonienne invite les humains au silence car la voix puissante du vent raconte toujours d’où il vient.” Dans le même silence, les gauchos chiliens, que l’on rencontre le lendemain, s’affairent et équipent les chevaux de l’estancia. Entre deux gestes précis et élégants, ils évoquent leur vie de baqueanos, la proximité des éléments, leur rudesse aussi. L’été marque le temps de la transhumance et les condamne à trois ou quatre mois de solitude. Ainsi vont l’homme et le cheval, très loin de la rumeur du monde. Et l’exploration du Chili se referme sur les notes du carnet de voyage de Sepúlveda : “En Patagonie, on dit que faire demi-tour et revenir en arrière porte malheur. (…) On ne doit avoir dans son dos que la guitare et les souvenirs.” Peut-être doit-on chercher là, au-delà de la poésie des mots, la sagesse du voyage.
Par
LAURIANE GEPNER
Photographies
ALIX PARDO