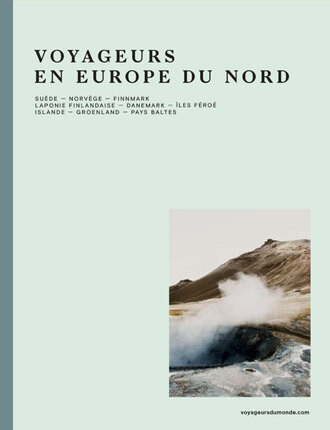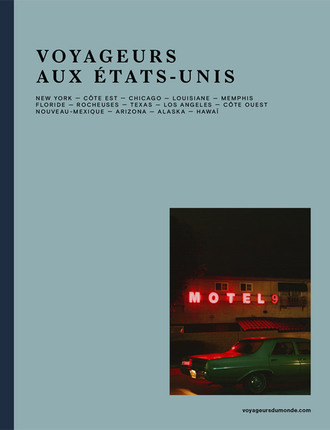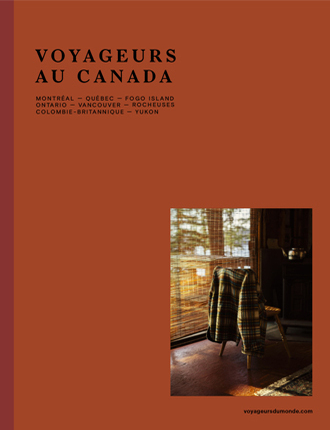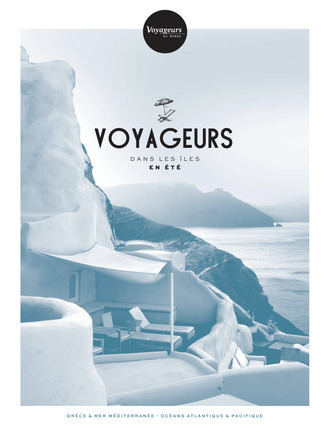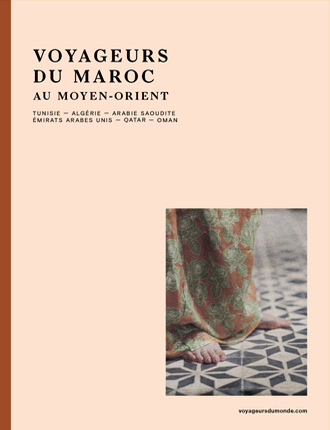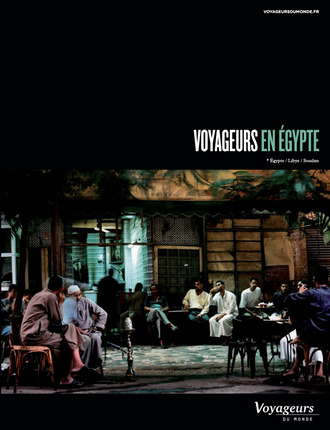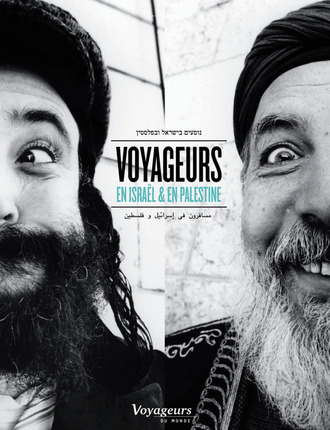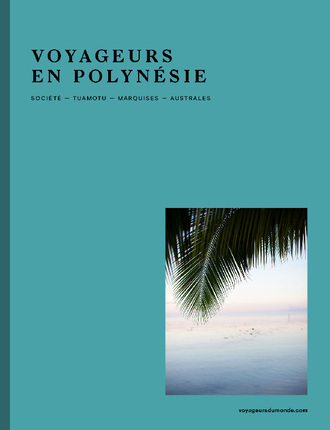Envoyer promener ses idées, débattre de l’actualité… : tel est l’objet de ce rendez-vous sans prétention donné par Jean-François Rial, le pdg de Voyageurs du Monde. Conversation avec Jean-Martin Fortier, propriétaire d’une microferme bio-intensive au Canada, engagé pour l’environnement.
La chemise à carreaux et le teint hâlé, le regard pétillant et la décontraction naturelle suffisent à deviner que la ville n’est pas son écosystème naturel. D’ailleurs, ce grand gaillard québécois se définit lui-même bien volontiers comme un “jardinier-maraîcher”. Outre le métier et la passion, c’est aussi le titre d’un best-seller paru en 2012 dont ce quadragénaire est l’auteur, vendu à plus de 100 000 exemplaires, et traduit en sept langues – dont le coréen. Des plateaux de télévision aux formations en ligne regroupant des centaines d’élèves dans plus de trente pays, Jean-Martin Fortier raconte l’histoire de son petit miracle écologique. En moins de quinze ans, ce génie agronome est parvenu à faire sortir de terre un nouveau modèle d’agriculture, à la fois biologique et intensif.

Greyfield Inn
Situés dans les verdoyants Cantons-de-l’Est, aux portes de Montréal, ses Jardins de la Grelinette (du nom de cet outil qui permet d’ameublir la terre sans la retourner) produisent sur un hectare l’équivalent d’une surface cinq fois supérieure cultivée au tracteur. Des rangs serrés, travaillés uniquement à la main par Jean-Martin, sa femme Maude-Hélène Desroches et une poignée d’apprentis bien décidés à gratter les enseignements de ce potager-laboratoire qui en plus de produire le meilleur mesclun du pays est naturellement beau. “Avec beaucoup de travail et un peu de chance, nous avons réussi à créer ce que Bill Mollison (pape australien de la permaculture – ndlr) appelait un ‘beau désert’”, sourit le gentleman fermier. Un écosystème simple dans lequel l’organisation ingénieuse permet de produire mieux. Bête comme chou ? Ce modèle de microfermes ultra-rentable fait grincer les rouages de l’agriculture industrielle, attire les investisseurs et germe en dehors des frontières de la Belle Province. Une révolution par le potager.
Jean-François Rial : Comment est née votre réflexion sur l’agriculture biologique ?
Jean-Martin Fortier : J’ai grandi dans une banlieue de Montréal plutôt conformiste, des maisons qui se ressemblent, encadrées de pelouses bien vertes… J’ai fréquenté de bonnes écoles, mais avant mon entrée à l’université, à 17 ans, j’ai acheté une voiture à 500 dollars et suis parti avec un copain faire un voyage de trois mois dans l’Ouest canadien. À mon retour, je me suis inscrit pour suivre des études en management. Ça a duré trois mois, puis j’ai laissé tomber pour repartir en Amérique centrale : Mexique, Guatemala, Salvador, Honduras. Ce voyage m’a ouvert l’esprit. Il m’a permis de sortir du schéma unique que je connaissais jusqu’alors, et partagé par la plupart des jeunes gens de mon âge. Ce sont mes rencontres, notamment avec d’autres voyageurs, qui m’ont apporté un certain éveil spirituel. À mon retour, j’avais vraiment envie de faire des études en lien avec la nature et les inégalités sociales. Je suis donc allé à l’université McGill pour suivre un cursus en études environnementales, durant trois ans. Mais j’ai toujours été sensible à l’environnement : l’été, je partais planter des arbres dans l’Ouest ou j’allais ramasser des morilles dans le Yukon. À l’université, j’ai rencontré beaucoup d’altermondialistes, dont ma future femme.

Vincent Mercier
J.-F. R. : La création d’une ferme biologique a-t-elle germé suite à cette période ?
J.-M. F. : À l’époque, nous rêvions simplement d’autre chose que d’une carrière administrative. Nous sommes partis au Mexique travailler quelques mois dans des fermes de café équitable, avant de remonter jusqu’au Nouveau-Mexique pour apprendre la construction de maisons alternatives dans le désert. Cela nous a ouvert les yeux. Là, nous avons travaillé pour un maraîcher québécois, Richard Bélanger, grâce à qui nous avons fait nos premières armes. Sur une surface de deux hectares, il produisait les plus beaux légumes de tous les environs de Santa Fe. Chaque samedi matin, les gens faisaient la queue devant son kiosque, il était remercié par tous, et il gagnait bien sa vie ! Nous avons ainsi découvert l’énergie positive qui entourait la communauté des agriculteurs, des personnes travaillant dur, mais accueillis comme des héros.
J.-F. R. : Cette vision du métier d’agriculteur vous a-t-elle guidé ?
J.-M. F. : Clairement. Ce premier contact avec le maraîchage bio a été déterminant. Je découvrais un métier qui signifiait travailler à l’extérieur, dans un bel environnement, être populaire, et générer des revenus confortables. À Santa Fe, nous avons finalement repris une exploitation en mauvais état, sur laquelle nous avons mené nos premières expériences pendant deux ans. Une période d’observation très constructive durant laquelle j’ai visité beaucoup d’autres fermes, et me suis nourri de nombreuses lectures sur l’agro-écologie. En deux années, nous avons appris énormément au contact de la communauté et par la mise en pratique de nos innovations. Au même moment, Hélène est tombée enceinte de notre premier enfant, nous avons alors décidé de rentrer au Québec.
« Ce sont mes rencontres, notamment avec d’autres voyageurs, qui m’ont apporté un certain éveil spirituel. À mon retour, j’avais vraiment envie de faire des études en lien avec la nature et les inégalités sociales. »
J.-F. R. : L’aventure aurait pu s’arrêter là, comment la transition s’est-elle opérée ?
J.-M. F. : Effectivement, le modèle que nous avions découvert – vivre sous un tipi et cultiver son jardin de manière non-mécanique – était loin de celui pratiqué au Québec. Mais nous étions décidés. Nous avons loué un lopin de terre, construit notre tipi et commencé à cultiver et vendre nos légumes par l’intermédiaire du réseau ASC (Agriculture soutenue par la communauté, soit l’équivalent québécois de nos Amap – ndlr). Deux saisons plus tard, nous avons acheté un terrain de quatre hectares au cœur duquel il y avait un clapier à l’abandon. Nous y avons créé un potager de moins d’un hectare et construit une maison inspirée des projets écologiques auxquels nous avions participé au Nouveau-Mexique. Une bonne alternative au tipi qui n’était vraiment pas adapté au climat québécois !
J.-F. R. : Les voyages ont-ils continué à nourrir votre inspiration ?
J.-M. F. : Sans aucun doute. Je rentre juste de Bretagne où j’ai pu observer chez un maraîcher bio une technique de filets à haricots. C’est tout simple, mais cela va changer beaucoup de choses pour moi. C’est en voyageant – en France, aux États-Unis, etc. – que ma réflexion évolue sans cesse. Je rêve de partir au Japon pour apprendre leurs techniques ancestrales. Avant de construire notre maison, l’hiver nous poussait à nous échapper. À Cuba notamment, où nous avons beaucoup appris sur les techniques de maraîchage nonmécaniques et sur l’agriculture bio-intensive (tels les organopónicos, ces potagers urbains cultivés en rangs serrés – ndlr). Au retour, nous avons mis en pratique sur notre hectare tout ce que nous avions appris, combiné à ce que j’avais pu lire sur la permaculture, de manière à organiser une bonne synergie entre les différents écosystèmes de l’exploitation. Un environnement dans lequel ils se nourrissent les uns des autres et génèrent une production durable.
J.-F. R. : Durable rime-t-il avec profitable ? Lorsqu’en 2005, vous avez créé les Jardins de la Grelinette, ce modèle de microferme biologique n’existait pas au Québec. Est-il rentable quinze ans plus tard ?
J.-M. F. : Après trois ans, la ferme l’était déjà. En cinq années, nous avions atteint le meilleur rendement à l’hectare de tout le Québec, soit un chiffre d’affaires annuel de 150 000 dollars. Des exploitations cinq fois plus grandes que la nôtre, entièrement mécanisées, ne font pas mieux. Donc, oui : l’agriculture bio-intensive est rentable. Aujourd’hui, nous avons déjà inspiré d’autres maraîchers biologiques qui réussissent très bien ! Je suis également impliqué dans un autre projet, la ferme des Quatre-Temps, un modèle de ferme de polyculture du futur. Elle a été pensée sur le principe de la permaculture, qui associe maraîchage bio et différents élevages gérés en milieu naturel et avec respect sur des espaces de pâturages en rotation. L’an dernier, la ferme a généré 500 000 dollars de chiffre d’affaires. L’objectif n’est pas de produire toujours plus, mais de produire mieux des produits de grande qualité, et d’avoir une plus belle qualité de vie.
« Ma mission est d’inspirer et de donner une méthode concrète aux maraîchers du monde entier pour les amener à créer des fermes à échelle humaine qui soient écologiques et rentables. »
J.-F. R. : Sur quels principes repose le succès de votre microferme ?
J.-M. F. : Si je devais résumer en une formule, je dirais : “Small is profitable”. La taille humaine de notre exploitation nous permet de gérer l’ensemble à deux ou trois personnes, sans tracteur mais avec des outils appropriés, ce qui minimise considérablement les coûts. Il s’agit de mettre l’agriculteur au centre du projet, son savoir-faire, sa passion, pas la machine. Le fait de travailler sur une petite surface nécessite d’intensifier notre production. Exit la classique culture en rangs, nous travaillons sur des bandes de terre surélevées (appelées planches – ndlr) qui ne sont jamais labourées, car ce sont les vers de terre qui le font pour nous ! Ces planches sont alimentées de manière organique avec un sol de grande qualité. Nous nous soucions en permanence de la santé des sols et des écosystèmes. Les légumes y poussent très serrés. Enfin, nous fonctionnons sur un circuit court de distribution, nous produisons des paniers de légumes de saison qui alimentent hebdomadairement deux cents familles de Montréal et sa région, et nous sommes présents chaque semaine sur les deux marchés fermiers des environs.
J.-F. R. : Pensez-vous que votre vision puisse s’exporter, en France notamment, et transformer le paysage agricole ?
J.-M. F. : Bien entendu. C’est l’idée des stages, de la formation en ligne, suivie dans une trentaine de pays, et des conférences que je propose. Ma mission est d’inspirer et de donner une méthode concrète aux maraîchers du monde entier pour les amener à créer des fermes à échelle humaine qui soient écologiques et rentables. C’est le moment ou jamais de remplacer la production de masse de l’agriculture industrielle par une production par la masse de petites fermes à échelle humaine. J’ai la conviction qu’ainsi nous viendrons à bout du poison et de la destruction créés par l’agriculture industrielle au profit d’un système alimentaire fondé sur le respect de la nature et de la communauté. Cependant, abandonner les intrants chimiques et faire changer les mentalités dans les grandes instances agricoles prend du temps. Je constate que la France est en mouvement sur cette réflexion. Il y a une prise de conscience chez les “citoyens-mangeurs”. C’est primordial, car eux seuls peuvent faire la démarche d’aller à la rencontre du producteur. De notre côté, nous devons continuer à apprendre en permanence. D’ailleurs, nous n’avons rien inventé : la plupart de nos méthodes s’inspirent de ce que faisaient les maraîchers au XIXe siècle, notamment autour de Paris. Les savoir-faire se sont partagés de génération en génération avant que la chaîne ne soit brisée par la mécanisation. Il ne s’agit pas de faire une révolution, mais c’est une autre façon de penser. Il faut rester humble et faire de son mieux.
Photographie de couverture
JULIEN MIGNOT