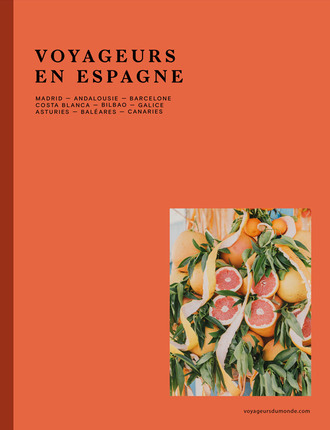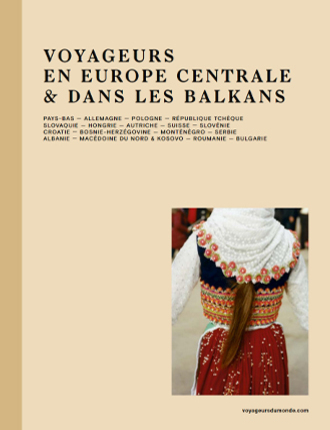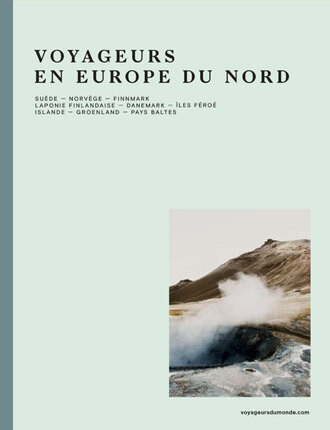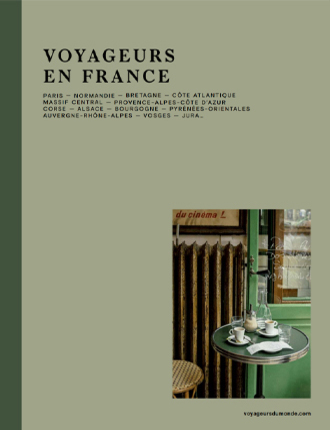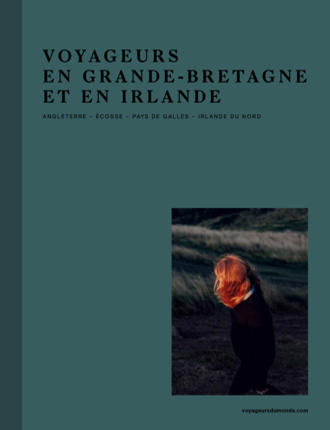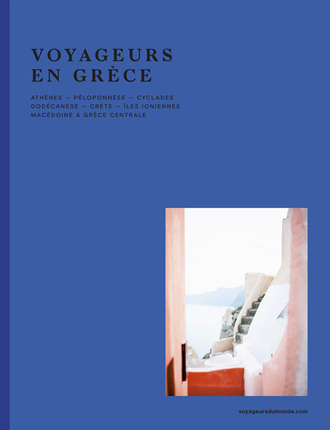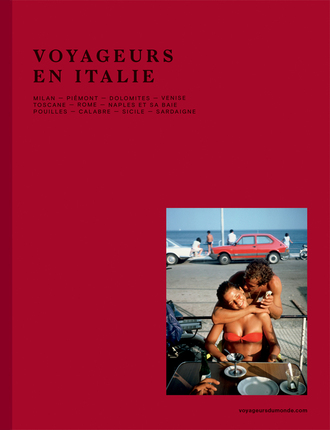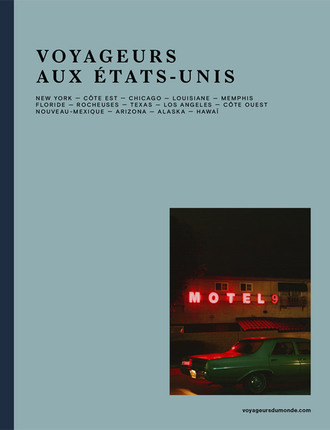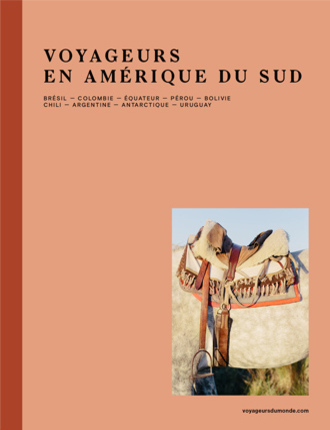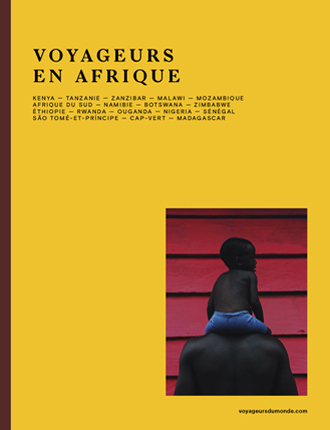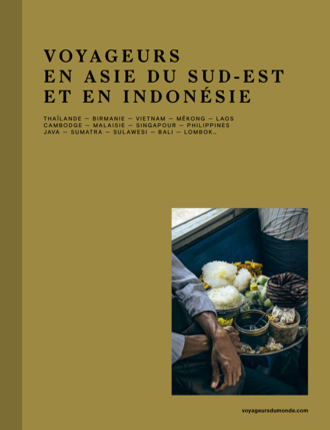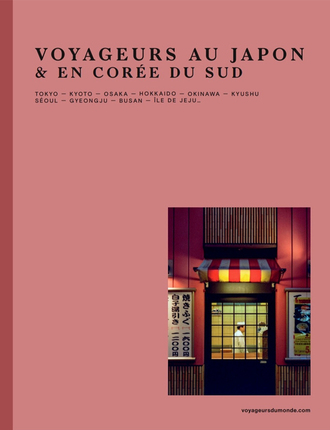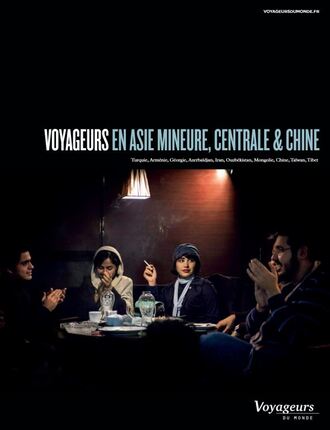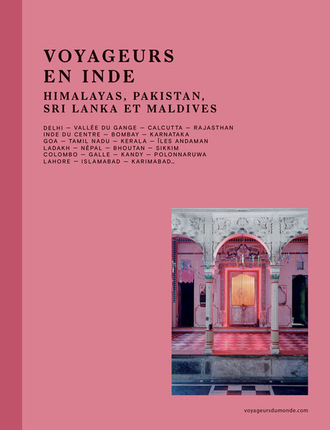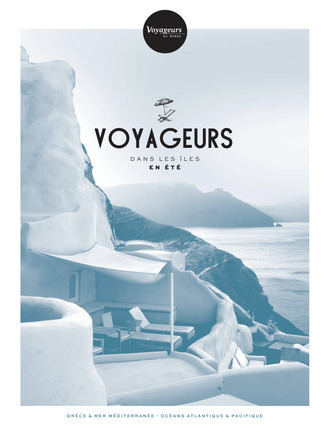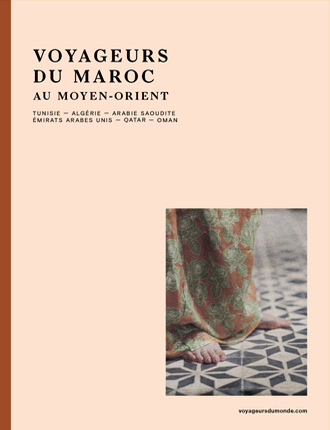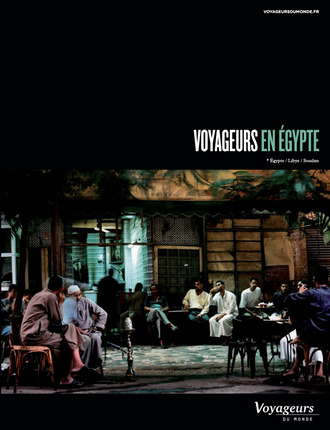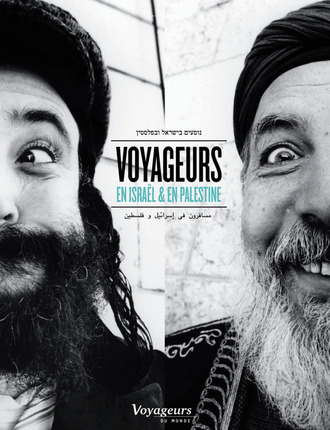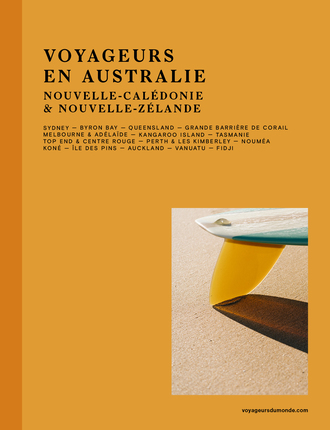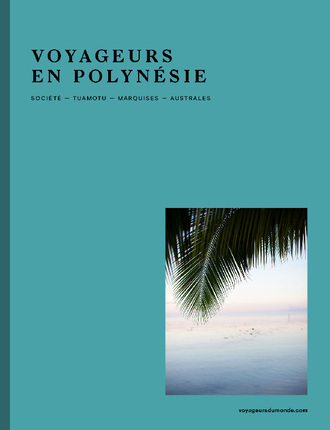Population
Langue officielle
Langues parlées
Peuples
Religions
En Égypte, on professe l’islam sunnite, largement majoritaire dans le monde musulman. En dépit de la présence d’une minorité intégriste fort remuante, le pays demeure plutôt tolérant. L’université al-Azhar du Caire est une institution savante dont le rayonnement s’étend largement au-delà des frontières égyptiennes.
Les chrétiens coptes – le terme signifiant égyptien – sont la première minorité religieuse d’Égypte. Cette confession miaphysite (une seule nature – divine – du Christ incarnée) est autocéphale, le patriarche d’Alexandrie étant son chef unique. On dit que l’église copte a été fondée par l’évangéliste Marc en personne. C’est l’une des plus anciennes églises chrétiennes.
Quelques milliers de juifs sont demeurés en Égypte, dont la situation varie selon les aléas de l’actualité.
Fête nationale
Calendrier des fêtes
7 janvier : Noël orthodoxe.
27 janvier : fête de la police.
25 avril : fête de la libération du Sinaï, 1982.
Cham El-Nessim : date mobile, le lundi de Pâques orthodoxe.
Fête du Petit Baïram : date mobile.
5 mai : fête du Travail.
30 juin : fête de la Révolution.
Fête du Grand Baïram : date mobile.
Eid al-Adha : date mobile.
23 juillet : fête nationale.
Fête de l’Hégire : date mobile.
6 octobre : fête des forces armées.
Naissance du Prophète : date mobile.
Les fêtes musulmanes et le ramadan relevant d’un calendrier lunaire, elles sont mobiles par rapport au calendrier grégorien commun.
Politique
C’est la constitution de 2014 qui règle le fonctionnement institutionnel et politique de la République arabe d’Égypte. Le président de la République (élu au suffrage universel direct pour un mandat de six ans renouvelable) est le chef de l’exécutif et dispose de pouvoir étendus. Il nomme le premier ministre et le cabinet, sur proposition de celui-ci. Le pouvoir législatif est assumé par un parlement bicaméral, composé de la Chambre des Représentants (chambre basse de 596 députés, élus pour un mandat de cinq ans) et du Sénat (chambre haute de 300 députés, élus pour un mandat de cinq ans). La Cour constitutionnelle suprême vérifie la compatibilité des lois avec la constitution. La Cour de cassation est la clé de voûte du système judiciaire. L’islam est religion d’État ; le christianisme et le judaïsme ont un statut officiel. La liberté religieuse et l’égalité des sexes sont formellement garanties par la constitution.
Histoire
Vers 4000 avant J.-C., il existe déjà un royaume de Haute-Égypte – au sud – et un autre de Basse-Égypte – au nord. Autour de 3100, le roi Narmer réunit les deux couronnes. Les plus anciens hiéroglyphes identifiés sont les deux qui forment son nom. Ce système d’écriture se met donc en place alors. L’Empire archaïque sera le creuset de la civilisation égyptienne. En 2700, avec la IIIe dynastie, naît l’Ancien Empire. Les pyramides de Saqqarah et du Caire sont édifiées au cours de cette période faste dont la divinité tutélaire est Horus à tête de faucon. Les systèmes religieux et administratif trouvent leur forme. Memphis est la ville pharaonique. Les meilleures choses ayant une fin, l’empire se morcèle et, après une période intermédiaire, le Moyen Empire commence à la fin du IIIe millénaire. Amon à tête de bélier présidant aux destinées de ces dynasties. La capitale est transférée à Thèbes / Louxor ; l’oasis du Fayoum et le delta du Nil sont mis en valeur. L’Égypte s’ouvre au Proche-Orient. Néanmoins, la pente fatale de la dislocation mène à une nouvelle période intermédiaire. Une population aux contours mal définis, les Hyksos, impose son hégémonie au nord. Les princes thébains s’accrochent à la Haute-Égypte.
Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, cependant, le roi thébain Ahmosis écrase les Hyksos. Il fonde la XVIIIe dynastie et ouvre les voies du Nouvel Empire. Phase brillante qui va durer jusqu’au XIe siècle avant J.-C. Les noms de Thoutmosis 1er et d’Hatchepsout, d’Akhénaton et Néfertiti, celui de Toutankhamon illustrent la XVIIIe dynastie. Akhénaton prétend remplacer le culte d’Amon et consorts par celui du dieu solaire unique, Aton. Une hérésie vite résorbée. Séthi 1er et Ramsès II installent la XIXe dynastie dans le delta du Nil. Si l’on attribue une valeur historique à l’épisode biblique, leur capitale, Pi-Ramsès, serait le point de départ de l’Exode des Hébreux. Les temples d’Abou Simbel et l’enceinte d’Amon-Re à Karnak sont du Nouvel Empire. Pourtant, celui-ci est affaibli par des déséquilibres internes ; au nord, les Berbères pénètrent dans le delta ; les Nubiens font sécession au sud ; et bientôt les Perses raflent la mise. La situation demeure instable, jusqu’à ce qu’en 332 survienne Alexandre le Grand, qui balaie les Perses, se fait reconnaître comme dieu et fonde Alexandrie. La mort l’emporte jeune et l’Égypte échoit à l’un de ses généraux, Ptolémée. Celui-ci reprend les choses où son mentor les avait laissées. Phare et bibliothèque d’Alexandrie, canal du Nil à la mer Rouge, restauration des grands sanctuaires : les Grecs offrent trois siècles d’une grandeur nouvelle à l’Égypte.
Le pays du Nil est intégré à la mondialisation hellénistique. Hélas, la dernière reine lagide, Cléopâtre VII, manque de nez (quoi qu’on en ait dit) ; elle prend le mauvais amant et l’Égypte est colonisée par Rome. Pax Romana donc et un évènement majeur, l’essor du christianisme. L’évangéliste Marc aurait fondé l’église d’Alexandrie vers 62 de notre ère. Donnant le christianisme à l’Égypte mais aussi l’Égypte au christianisme. L’apport de l’école d’Alexandrie – Clément, Origène, Cyrille – sera déterminant pour le développement théologique de celui-ci. Les pères du désert d’Égypte sont à l’origine du monachisme chrétien. Tabennèse, fondé en Haute Égypte par saint Pacôme, en est le premier modèle. Sous la houlette de Constantinople, le christianisme est religion d’État. Le vieil ordre polythéiste est concurrencé dans les temples-mêmes par la nouvelle foi. Et les choses vont leur train byzantin jusqu’à ce qu’en 639 les Arabes envahissent le pays.
L’Égypte vit dès lors au rythme des dynasties arabes et musulmanes. VIIe-IXe siècles, les Omeyyades et les Abbassides transfèrent le centre du pouvoir à Damas, puis Bagdad. L’Égypte, un peu provincialisée, bénéficie pourtant des échanges au long cours que favorise le nouveau monde musulman. Ce sont les Fatimides chiites qui fondent Le Caire en 973, remettant l’Égypte au centre du jeu politique et économique. Il est sans doute significatif que la conversion des Égyptiens à l’islam, jusque-là négligeable, s’enclenche à cette période. Au XIIe siècle, le Kurde Saladin rétablit l’orthodoxie sunnite et fonde la dynastie ayyoubide. En février 1250, les Ayyoubides bloquent les entreprises de la 7e Croisade : saint Louis, qui vient de prendre Damiette, est fait prisonnier à la bataille de Mansourah, près du Caire. Néanmoins l’effort franc (combiné à la cécité politique d’un nouveau sultan, Tûrân Châh) a favorisé la montée en puissance des miliciens mamelouks. Lesquels prennent – puis détiennent jusqu’au XVIe siècle – le pouvoir. C’est sous bien des aspects un âge d’or pour l’Égypte. Le Caire est embelli : mosquée d’An-Nâsir Muhammad, mosquée du Sultan Hassan, renaissance de Qa’it Bay, etc.
Autoritaires et centralisateurs, les mamelouks n’en sont pas moins avisés et le pays tire avantage du commerce entre l’Orient et l’Occident, dont il est une plaque tournante. Las ! L’ouverture de la route méridionale vers les Indes ruine le régime et, en 1517, les Turcs ottomans s’emparent de l’Égypte. Le gouvernement des pachas tangue au gré des luttes intestines entre mamelouks et janissaires. La rivalité franco-britannique s’invite au bord du Nil. De 1798 à 1801, l’expédition de Bonaparte et ses suites remettent celui-ci au contact de l’Occident. Et l’Occident à son contact. L’égyptologie – doublée d’égyptomanie – nait alors. Après un intermède British, ce sont pourtant les Turcs qui installent le fondateur de l’Égypte moderne, le pacha albanais Mehmet Ali. Lequel, s’étant débarrassé sans états d’âme de mamelouks peu fidèles, consacre qarante années à développer les institutions et l’économie. Le coton égyptien prend son essor. Mehmet Ali gagne en autonomie et étend ses possessions. Jusqu’à inquiéter les Britanniques. Afin de préserver les intérêts des puissances occidentales, ils brisent l’élan du pacha – traité de Londres, 1840. Dont les successeurs (ayant pris le titre de khédive) poursuivent vaille que vaille la politique de développement. En 1869, Ferdinand de Lesseps supervise le percement du canal de Suez. Le grand commerce international retrouve le chemin de l’Égypte.
Le ratio investissements occidentaux / instabilité politique locale semble rapidement défavorable aux Britanniques et aux Français. Les premiers s’installent en 1882 et imposent un protectorat en 1914, qu’ils font confirmer après que l’empire Ottoman a perdu la 1ère Guerre mondiale côté Empires centraux. Le haut-commissaire britannique est désormais le patron de l’Égypte. Et le canal de Suez sous l’Union Jack. Pendant ce temps, le puissant mouvement national égyptien s’est structuré, autour du parti Wafd de Saad Zaghloul notamment. En 1922, l’indépendance du Royaume d’Égypte est négociée avec les Britanniques ; mais la tutelle demeure. 1936, nouvel accord sur le retrait des troupes de Sa Gracieuse Majesté : elles partent tout en restant. Pendant la 2nde Guerre mondiale, le roi Farouk maintient la neutralité de principe de son pays mais il est obligé d’accepter le stationnement des soldats britanniques sur son sol. L’Égypte est un bastion allié. Les deux batailles d’El Alamein ont une importance décisive pour le front nord-africain. Parallèlement, le nationalisme trouve en tout cela des aliments. En 1948, la création de l’État d’Israël change la donne régionale. L’Égypte est au premier rang des guerres israélo-arabes. Le régime semble peu adapté au nouveau désordre mondial. Il est renversé en 1952 par un coup d’État du mouvement des Officiers libres, dirigé par Gamal Abdel Nasser, Salah Salem et Abdel Hakim Amer.
C’est bientôt Nasser qui tient les rênes. Il noue des liens étroits avec l’Union Soviétique, nationalise le canal de Suez – 1956, l’intervention militaire franco-britannique échoue : fin d’une époque – promeut le panarabisme et fait du pays l’un des phares du tiers-monde. Anouar el-Sadate succède à Nasser. Après la guerre du Kippour de 1973, sa politique marque une nette inflexion. Partenariats politiques et économiques renouvelés, arrêt des conflits à répétition avec Israël. En 1978, les accords de Camp David et le traité de paix israélo-égyptien qui suit quelques mois plus tard, marquent la reconnaissance formelle de l’État hébreux par l’Égypte et entrainent la restitution du Sinaï, perdu lors de la guerre des Six Jours de 1967. L’assassinat de Sadate en 1981 (situation intérieure tendue) consterne le monde. Hosni Moubarak hérite alors d’un pays qui s’est acquis une place en vue dans le concert des nations. Et qui s’est acquis une maturité politique suffisante pour lui signifier en 2011 que tous les règnes ont une fin. Le Printemps arabe et les élections amènent au pouvoir Mohamed Morsi, issu de la Société des Frères musulmans. L’expérience tourne court et rapidement Abdel Fattah al-Sissi et l’armée reprennent la main.
Personnalités
Boutros Boutros-Ghali, 1922-2016. Ce membre d’une grande famille de la bourgeoisie copte fut d’abord un spécialiste reconnu de droit international. On se le rappelle surtout pour avoir été secrétaire général de l’ONU de 1992 à 1996, mais il fut aussi, pour ne citer que cela, l’un des négociateurs des accords de Camp David en 1978. Infatigable combattant de la paix, il est l’archétype de l’Égyptien humaniste.
Oum Kalthoum, 1898-1975. La chanteuse arabe. Voix d’exception et flamboyante militante de la cause de son peuple. Exclusive dans ses attachements, elle ne s’est pratiquement jamais produite en Europe : premiers concerts en 1967, à l’Olympia. Elle acquit dans tout l’Orient un public aux dimensions de son génie et eut, à sa mort, des funérailles nationales. On ne peut évoquer la musique arabe du XXe siècle sans passer par elle.
Naguib Mahfouz, 1911-2006. Il fallait un prix Nobel à l’Égypte, ce fut Mahfouz, littérature, en 1988. Ses romans décrivent une société égyptienne oscillant entre deux civilisations, traditionnelle et occidentale. Le Caire constituant pour lui sans doute l’espace littéraire par excellence. Il n’a pas révolutionné le style, mais la lecture d’un de ses livres est toujours un beau moment de plaisir et d’intelligence.
Dalida, 1933-1987. Née Iolanda Cristina Gigliotti, au Caire. Si les parents sont d’origine calabraise, la petite est certainement une enfant du faubourg populaire de Choubra. Avant de s’envoler pour la France, elle aura d’ailleurs le temps d’esquisser une carrière égyptienne : on se rappelle peut-être Un verre, une cigarette, de Niazi Mostafa, 1955, où elle croise l’éblouissante Samia Gamal.
Farid El Atrache, 1910-1974. Né d’un père druze et d’une mère libanaise – tous deux de haute lignée – Farid el Atrache est un Égyptien d’adoption. Ce qui ne diminue en rien l’attachement que les Égyptiens de souche ont pour le virtuose du oud, le compositeur d’exception et l’acteur au charme un peu Droopy. Un air triste qui s’est communiqué à tous ses moyens d’expression. La mélancolie était son style et un mode de vie exalté ne fut de cela que la discrétion.
Lina Attalah, née en 1983. Entre autres, fondatrice et rédactrice en chef du journal en ligne Mada Masr, Lina Attalah est par son talent et son énergie un sérieux poil à gratter pour le conformisme égyptien. Et la cible de nombreuses tentatives d’intimidation. Il en faudra sans doute plus pour mettre sous l’éteignoir celle que Time a classée en 2020 parmi les 100 personnalités les plus influentes.
Mohamed el-Baradei, né en 1942. Passé de la diplomatie à l’AIEA, juriste et fin connaisseur des institutions internationales, Mohamed el-Baradei s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix en 2005 pour l’action que l'International Atomic Energy Agency et lui-même ont menée contre la prolifération nucléaire. En Égypte-même dans les années 2010, son activité politique, même marquée par un souci de cohérence, a déçu.
Laila Soueif, née en 1956. Issue d’une famille d’intellectuels progressistes, professeure de mathématiques à l’université du Caire, Laila Soueif défend avec vigueur les droits de l’homme et ceux des femmes. Un engagement qu’elle partageait avec son mari, Seif El-Islam, mort en 2014. Et que prolongent ses enfants. Ainsi Alaa Abdel Fattah, informaticien et blogueur ou Mona Seif, figure de la révolution de 2011.
Hassan el-Banna, 1906-1949. Sensible très jeune aux aspects juridique et moral de l’islam, il aborde ensuite logiquement les questions religieuses sous un angle social et politique. La Société des Frères musulmans, qu’il fonde en 1928, vise à islamiser en ce sens la vie des Égyptiens. Ce combat se heurte à l’occidentalisation du pays ; les Frères seront des adversaires farouches de celle-ci et de ses agents. Ce qui sans doute valut à Hassan el-Banna les balles et la mort.
Abeer Abdelrahman, née en 1992. Cette haltérophile est d’abord classée cinquième aux jeux olympiques de 2008 et de 2012. Ce qui n’est pas mal. Le contrôle antidopage ayant par la suite fait le ménage sur les podiums, une médaille de bronze et une d’argent lui sont finalement attribuées. Ce qui est mieux. Tant pour les qualités athlétiques que pour le comportement net de cette femme forte.
Savoir-vivre
Le pourboire est à l’appréciation des clients. Pour toute personne intervenant dans le cadre des prestations achetées par notre intermédiaire, il ne se substitue jamais à un salaire. Néanmoins, il est d’usage un peu partout dans le monde de verser un pourboire lorsqu’on a été satisfait du service.
En ce qui concerne le personnel local – serveurs, porteurs, etc. – les usages varient. Le mieux est d’aligner votre pourboire sur le prix d’une bière, par exemple, ou d’un thé, d’un paquet de cigarettes. Il vous donne un aperçu du niveau de vie et vous permet, comme vous le faites naturellement chez vous, d’estimer un montant. Pour les chauffeurs de taxi, on arrondit le prix de la course. Dans les hôtels de standing, 1 euro par bagage au bagagiste. Au guide, on peut laisser jusqu’à 10 euros par jour et par personne.
Pour être dans la note égyptienne, on peut toutefois noter les indications suivantes : 50 livres à un bagagiste ; 100 livres par jour à votre contact sur place ; 150 livres par jour au chauffeur ; 300 livres par jour au guide. Au restaurant, 10% du montant de l’addition sont dans la norme.
L’Égypte est un pays musulman et impose à ce titre quelques règles de savoir-vivre.
Les dames évitent les tenues provoquantes – minijupes, minishorts, hauts ouverts – et elles se couvrent la tête pour entrer dans les mosquées (seul cas).
Lorsqu’on est invité à partager un repas familial, on attend pour commencer que le maître de maison ait dit bismillah (au nom de Dieu). On mange avec la main droite. On goûte à tout, sans pour autant se sentir obligé de nettoyer son assiette.
Pendant le ramadan, on évite de boire, de manger ou de fumer en public pendant la journée.
De façon générale, on se déchausse avant d’entrer dans une pièce ; impératif si des chaussures s’alignent déjà sur le seuil à votre arrivée.
Pas de photo d’une personne sans son autorisation.
Si le cas se présente, on évite d’encourager la mendicité, spécialement celle des enfants, en faisant des distributions sauvages dans la rue. Si l’on souhaite apporter une aide en fournissant du matériel scolaire, des vêtements ou des médicaments, il est préférable de les remettre au directeur d’école, au chef du village ou au dispensaire le plus proche, qui sauront en faire bénéficier les plus démunis.
L’utilisation de drones est soumise à une autorisation spécifique.
Le commerce et l’exportation d’artefacts archéologiques sont interdits
Cuisine
La cuisine égyptienne vaut mieux que sa réputation de médiocrité. C’est toutefois une cuisine sous influence (orientale) : Liban, Syrie, Turquie. Grecque aussi. Le pain en est sans nul doute l’élément central. En tout cas, on ne fait pas sans lui et, dans le pire des cas, on ne fait qu’avec lui. Sinon, pas mal de légumineuses, pois chiches, petits pois, lentilles, haricots, les indispensables fèves. Et des légumes, que les berges du Nil fournissent en abondance : tomates, aubergines, courgettes, etc. On trouve de beaux fruits. La semoule et le riz constituent des bases appréciées. On n’est pas pour autant végétarien. Ovins et bovins fournissent aux tables. Lesquelles accueillent aussi pigeons, poulets, lapins. Le poisson est relativement rare hors des régions côtières. Les mélanges sont appréciés. Ainsi trouve-t-on dans le kochari, du riz, des macaronis, des lentilles et des oignons, plus quelques adjuvants. Diététiquement, cela se tient. Dans un autre style, la mloukhiya est un ragout – de poulet, par exemple – aux feuilles de corète potagère. Le plat remonterait à l’Égypte ancienne. On farcit volontiers, des légumes (mahshi) ou des pigeons (hamam mahshi). Pour la pâtisserie, du miel, des dattes, des pignons, des pistaches.
Street food : incontournable, ubiquitaire, le foul – les fèves mijotées – est le plat populaire n°1. On le mange dans une assiette ou dans un demi-pain pita, assis, debout et n’importe quand. Le pain étant un contenant pratique, puisqu’il est une assiette ingérable, on le garnit aussi volontiers de chawarma ou d’abats de mouton. Hawawshi est un plat de cette catégorie : fourré de viande émincée, oignons, poivre, persil, éventuellement piment. Pour la bonne bouche, kebda eskandarani est une spécialité des rues d’Alexandrie, qui consiste en foie de bœuf frit épicé servi dans un pain avec oignons et piments frais. Les Égyptiens tiennent leurs falafels pour les meilleurs du monde. On farcit de riz épicé les courgettes ou les tripes (mombar), chaque formule trouvant ses défenseurs. Parmi les nombreuses pâtisseries dont on peut se régaler dehors, relevons le feteer, plusieurs couches de pâte, beurre clarifié et garniture sucrée.
Boisson
L’eau du robinet n’est pas aux standards européens, on s’en abstient donc. Pour boire de l’eau minérale en bouteille capsulée, des sodas, de la bière.
Le thé et le café sont deux vieux compagnons des Égyptiens. Le premier est servi brûlant, éventuellement à la menthe (mais il faut le demander expressément). Le second est préparé à la façon turque. On sucre l’un et l’autre.
Les jus de fruit frais sont innombrables, délicieux et servis glacés. Fréquemment allongés d’eau (voir notre premier alinéa). On choisit donc d’abord le lieu où on en boit.
La boisson phare est le karkadé, infusion de fleurs d’hibiscus servie soit chaude, soit froide. Chaude, vous êtes assuré de son innocuité. Et c’est excellent contre l’hypertension.